2. La dialectique de l´Homme et la Nature
2.1 La relation de l’Homme et de la Nature : il n’y a pas de divorce entre l’Homme et la nature
2.2 La vie, la conscience sont des propriétés de la nature
3. Conséquences imprévues de l’action de l’Homme sur la nature
3.1 Actions réciproques entre l’Homme et la nature
3.2 La bourgeoisie continue de réformer la société
4.1 Les virus et la dialectique, le vivant et les origines de la vie
4.3 Les virus ne sont pas forcément dangereux
5. Mathématisation des études sur la diffusion des maladies contagieuses
5.1 Difficultés pour la prédiction de la propagation des maladies infectieuses
5.2 Petit historique de la modélisation mathématique en épidémiologie
5.3 Avons-nous besoin d’une multitude de modèles ?
6. La société communiste ne sera pas exempte des menaces virales
1. Présentation
Au long de son histoire, l’espèce humaine a subi nombre d’épidémies dévastatrices ; par exemple, les maladies épidémiques du néolithique, la peste d’Athènes, l’épidémie de variole dans l’Empire Romain et l’Egypte, la peste noire au Moyen Âge, la grippe espagnole, le typhus dans la révolution russe … Si les communautés primitives ont subi des maladies infectieuses, la contagion était limitée du fait de l’isolement relatif des communautés. Cependant, dès le néolithique, la domestication des animaux modifie leur relation avec l’espèce humaine. L’accroissement de la productivité de l’agriculture permet la création de villes tandis que les différenciations sociales s’exacerbent et que des classes sociales aux intérêts antagoniques se forment. Les premières épidémies apparaissent alors en relation avec les sociétés de classes ; les intérêts immédiats des classes dominantes sont devenus le moteur de la production. Elles agissent sans se soucier des conséquences indirectes et futures de leurs actions sur la nature. La pandémie liée au COVID19 n’est donc pas un phénomène spécifique au mode de production capitaliste[1], mais celui-ci amplifiait dramatiquement ses conséquences sur l’ensemble de la planète.
Cette épidémie a révélé, aux yeux de tous, l’incurie et l’incompétence des bourgeoisies nationales à maîtriser la situation. Au lieu d’une coordination globale, s’imposaient la concurrence, les pressions, les mensonges que se font les Etats bourgeois et l’impuissance totale des organismes internationaux censés représenter « l’intérêt commun et la solidarité des nations » (OMS, ONU…). Dans la plupart des pays, le prolétariat a assisté à l’incapacité de la bourgeoisie à diriger le système de santé et à prendre en charge rationnellement la protection des populations, malgré les immenses progrès de la médecine au XXe et XXIe siècles. Tous les gouvernements, quels que soient leurs orientations idéologiques, ont cherché avant tout à préserver les rapports sociaux et politiques qui permettent la production d’un maximum de plus-value et la soumission du prolétariat à l’ordre bourgeois. Les mesures d’exception qui étaient prises, au nom de la sauvegarde de la santé des populations préparaient aussi, et à grande échelle des mesures durables d’aggravation des conditions d’existence de ces populations, en termes de revenus, de temps de travail et de chômage, et de régression des libertés démocratiques tout en développant de nouvelles méthodes de domination du prolétariat. La classe dominante prend les devants pour faire payer au prolétariat les frais de cette crise, en faisant tout pour l’immobiliser dans sa réaction de classe, alors même qu’avant l’épisode du coronavirus, la lutte des classes à l’échelle mondiale s’intensifiait.
Cette épidémie éclatait alors que le mode de production capitaliste était sur la fin d’un cycle – le plus long cycle de son histoire moderne – et que la société bourgeoise était grosse d’une nouvelle crise de surproduction plus menaçante que la dernière crise de 2008-2009.
Devant cette perspective, les bourgeoisies des pays avancés ont déployé, bien avant l’éclatement de la crise sanitaire, toutes les ressources de la politique monétaire et budgétaire pour tenter de l’enrayer. Cette crise épidémique intervenait avant l’explosion de la crise de surproduction et précipitait prématurément la dévalorisation d’une partie du capital. Une très grande partie de la production et de la circulation des marchandises était soudainement arrêtée tandis que le capital fictif chutait considérablement ; les dévalorisations réalisées ont différé la crise de surproduction et pour autant qu’elles aient été suffisamment importantes ont mis fin au onzième cycle de l’après-guerre (selon notre numération) avec l’aide d’une politique de soutien massive.
De toutes façons, qui paye la facture de l’endettement sans précédent de tous les Etats paniqués à l’idée de l’effondrement de la société bourgeoise ? Principalement, le prolétariat, qui voit son exploitation renforcée pour produire un maximum de plus-value et permettre la valorisation du capital, fortement dévalorisé par cette crise, et supporter le poids dela dette publique.
Tandis que l’épidémie continue tout en ayant une accalmie et que la bourgeoisie considère que cela ne lui pose plus de problèmes politiques, les prémisses d’une troisième guerre mondiale se mettent en place. A la fois contre-coup de la défaite du « socialisme réel », c’est-à-dire du capitalisme à l’Est de l’Europe et première remise en cause fondamentale de l’ordre impérialiste dominé par les Etats-Unis, la guerre en Ukraine est devenue un champ clos où par l’intermédiaire du peuple ukrainien s’expriment les rivalités inter-impérialistes et sont un premier pas dans la polarisation des forces qui déboucheront sur un troisième conflit mondial. La bourgeoisie de l’Europe de l’Ouest, bien qu’elle soit loin d’avoir une politique unanime, est conduite dans l’urgence à un réalignement de ses forces qui la conduit à imposer des mesures d’austérité au prolétariat tout en augmentant ses dépenses d’armement tandis que la dette publique et la charge des intérêts augmentent. Une inflation difficilement contrôlable sur le court terme, mais cette inflation – à un niveau moindre - a longtemps été recherchée sans succès, en est une conséquence tandis que des pénuries s’installent.
C’est bien dans les grandes crises mondiales que se révèle toujours le caractère tragique de la division en classes. Le mode de production capitaliste, dernier mode de production basé sur les classes sociales, révèle à cette occasion combien il a fait son temps, et combien son renversement par la classe exploitée, le prolétariat mondial, est le seul objectif qui peut faire sens devant les conséquences de sa domination. Pourtant, depuis sa défaite dans les années 1920, le prolétariat a disparu comme classe indépendante. Si par la suite, il a pu émerger au sein des révolutions qui ne dépassaient pas les limites bourgeoises, pour autant qu’elles fussent radicales, il n’a pas réussi à s’y affirmer comme classe. Certes, la capacité politique du prolétariat dépend des circonstances, de son degré de préparation et de son énergie pour s’organiser de façon indépendante à l’échelle internationale, mais sa capacité historique est permanente, parce qu’elle est inscrite au cœur même du rapport social qui caractérise le mode de production capitaliste. Pour préserver cette capacité quand les rapports de force lui sont défavorables, il faut que le prolétariat, sous le drapeau de la révolution en permanence, trouve un moyen de coopération internationale qui lui permette de se défendre au mieux pour protéger ses conditions d’existence tout en se préparant à former un parti politique indépendant et opposé à tous les autres partis de la société bourgeoise.
Robin Goodfellow – Février 2023
2. La dialectique de l´Homme et la Nature
La pandémie liée au COVID19 et la surréaction qu’elle a provoquée dans nombre de pays, ont favorisé le discours écologiste. Selon cette interprétation, l’activité humaine en s’attaquant à la nature sauvage, notamment à travers la déforestation, et en particulier celle des forêts tropicales, en viendrait à perturber des écosystèmes qui auparavant étaient équilibrés et expose l’Homme à de nouveaux virus qui le menacent[2]. Dans le même ordre d’idée, par exemple, le réchauffement climatique menace de libérer des virus enfouis dans le permafrost sibérien qui peuvent se révéler particulièrement néfastes pour l’Homme. Aux thèses religieuses qui voient dans les catastrophes un fléau de Dieu pour punir les hommes de leurs péchés ou une manifestation du démon, un nouveau mysticisme y voit une vengeance de la Nature saccagée pour le plus grand prédateur de tous les temps : l’Homme.
2.1 La relation de l’Homme et de la Nature : il n’y a pas de divorce entre l’Homme et la nature
L’Homme devrait donc s’arrêter à la lisière de la forêt, ne pas y toucher, la laisser vivre sa vie pour que la biodiversité puisse s’épanouir. Cette biodiversité, dont on ignore la plus grande partie[3], supposée implicitement chargée de bienfaits pour l’Homme puisqu’il doit la protéger, se révèle alors une terrible menace porteuse de calamités. Mais la petite-bourgeoisie démocratique n’en est pas à une contradiction près. Il est vraisemblable que cette argumentation qui, de fait, met en exergue les dangers de la biodiversité, vient en soutien et en substitution de l’argument selon lequel la forêt vierge tropicale était une composante essentielle de la lutte contre le réchauffement climatique en séquestrant du carbone. Las, les études ont montré que ces forêts étaient bien un poumon de la planète dans le sens où, comme le poumon, elles rejettent du gaz carbonique. Les forêts, toutes choses égales par ailleurs, n’emmagasinent du gaz carbonique que quand elles poussent ; les arbres morts qui pourrissent finissent par libérer le carbone qu’ils ont stocké. Une forêt « vierge » ou autre forêt « primaire » (concept dont on peut douter de la réalité effective) si nous raisonnons abstraitement serait donc neutre[4], la production nouvelle serait compensée par la mort d’autres arbres. Il faut donc la main de l’Homme qui doit exploiter le bois pour que, sous diverses formes (meubles, matériaux de construction, pâte à papier, chauffage, …), le bois stocké et utilisé en dehors de la forêt augmente, tandis que celle-ci, par le choix des espèces en fonction des besoins est gérée plus rationnellement (aujourd’hui dans les limites de la production capitaliste et de la propriété privée, qui sont autant d’obstacles à une telle gestion et que la petite-bourgeoisie démocratique se garde bien de critiquer autrement que sous la forme mystificatrice de l’adjectif productiviste, intensif ou industriel)) et voit sa pousse favorisée. Reste la question de l’enfouissement de ce carbone dans le sol ; sa sédimentation (charbon, pétrole, kérogène, roches sédimentaires, etc.). Le sol retient effectivement beaucoup plus de carbone que la biomasse. D’une part, les forêts tropicales sont les moins efficaces de ce point de vue. Il y a comme une relation entre la biomasse et le carbone stocké dans le sol. Plus la biomasse prend de l’importance, moins le sol stocke de carbone. D’autre part, les forêts ne sont pas les seuls terrains où on stocke du carbone ; les prairies et autres terres agricoles en conservent également et souvent plus que les forêts[5].[6]
Hier, la peur du loup et de forces mystérieuses au sein des forêts hantaient l’imaginaire occidental, aujourd’hui c’est l’atteinte à la biodiversité, la menace des virus du fait du contact avec la faune sauvage. Comme si l’Homme n’avait pas été, de tout temps, en contact avec la faune sauvage ! qu’est-ce-donc d’autre que la chasse ou la pêche ? De plus, comme l’ont montré de nombreuses images, insolites[7] ou non, si l’Homme se tient éloigné de la nature, celle-ci se rapproche de l’Homme[8]. N’oublions pas non plus, comme nous l’avons rappelé, que la majeure partie des épidémies qui ont comme vecteur l’animal vient des animaux domestiqués[9]. Et que dire alors des populations qui vivent au milieu de ces forêts et dont la petite bourgeoisie démocratique prend volontiers la défense. Elles furent plus facilement décimées par les virus européens que par ceux qu’elles auraient pu rencontrer au contact de la faune sauvage locale qu’elles consomment par ailleurs[10]. La consommation d’animaux sauvages par les Chinois aura permis, par la même occasion, un déferlement de commentaires condescendants, y compris chez les mangeurs de grenouilles, d’escargots et d’ortolans, sur les pratiques culinaires chinoises[11].
Il n’y a pas de divorce, de fossé, entre l’Homme et la nature, comme le suppose la pensée métaphysique ; la nature n’est pas un système stationnaire et harmonieux opposé à un homme en mouvement qui la saccage. Bien au contraire, l’espèce humaine et son histoire sont la manifestation du devenir de la nature. Selon la théorie marxiste, sur la Terre, l’Homme en tant qu’espèce est l’animal « (…) vertébré dans lequel la nature prend conscience d’elle-même. » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.41). « L’Homme fait de son activité vitale elle-même l’objet de sa volonté et de sa conscience. Il a une activité vitale consciente. (…). L’activité vitale consciente distingue immédiatement l’Homme de l’animal. C’est par là seulement qu’il est un être générique. Autrement dit, il est un être conscient, et sa propre vie est pour lui un objet précisément parce qu’il est un être générique. » (Marx, Manuscrits parisiens de 1844, Pléiade, Economie, T.2, p.63)
Et l’Homme comme espèce - tout comme l’ensemble du monde inorganique et organique, et toutes les espèces (micro ou macro-organismes) connus ou encore inconnus, actuels ou disparus (c’est la partie et de très loin, la plus importante) – est le produit du devenir de la nature et de ses lois ; lois que l’Homme s’efforce de connaître pour les mettre à son service.
Pour le marxisme, l’Homme est donc une des formes par laquelle la nature est parvenue à la conscience d’elle. L’humanisation de la nature ; l’Homme redessine le paysage, cultive les champs, plante les arbres, les coupe, entretient le sous-bois, bref gère les forêts, arase les collines, perce les montagnes, détourne les fleuves, assèche les marais, conquiert des territoires sur la mer, sélectionne et crée des espèces, sauve des variétés qui seraient étouffées dans la nature, fait des greffes, croise des variétés et des espèces, modifie génétiquement les organismes, …, s’accompagne de la naturalisation de l’Homme ; l’appropriation empirique ou théorique des lois de la nature[12] lui permet de les faire agir pour son usage et permet à l’Homme de se doter de capacités qu’il n’avait pas à l’origine. Par exemple, il peut désormais voler, vivre sous l’eau, voir au-delà et en deçà de son œil, … nous pourrions multiplier à l’infini les qualités naturelles qu’il a incorporées ou celles qu’il a développées en allant au-delà même de ce que pouvait faire la nature par elle-même en découvrant ses lois et les mettant à son service ; la nature elle-même, dans la mesure où l’Homme en est une composante et qu’il la façonne, élargit ses caractéristiques. Pour exister à ce niveau de complexité et pour évoluer vers une complexité encore plus importante, la nature a toujours plus besoin de l’action de l’Homme[13]. Comme la conscience est une propriété de la nature, le marxisme n’a jamais placé l’Homme au centre du monde, mais comme une des manifestations de la conscience supérieure de la nature et donc, dans ce mouvement, il admet que, ailleurs ou demain, le mouvement de la nature conduise celle-ci à la conscience d’elle-même par d’autres voies que celle de l’Homme. Il montre aussi à quel point cette nature est d’un « rendement » dérisoire. Combien de matière inorganique, d’espaces infinis, de galaxies, combien de temps, pour arriver à la production d’une quantité infime de matière organique et encore plus infime de sensibilité et de conscience. Quant à la nature consciente d’elle-même, telle que nous la connaissons, elle est encore plus dérisoire, aussi bien dans le temps comme dans l’espace, du point de vue quantitatif[14].
Avec le mode de production capitaliste ce processus d’humanisation de la nature et de naturalisation de l’Homme prend un tel essor, sous la forme d’une exploitation généralisée de l’Homme et de la nature, que, par rapport à lui, les autres formes de production paraissent limitées[15].
Précédent la conception matérialiste de la dialectique de la nature, figure la conception idéaliste de la dialectique de la nature de Hegel. Selon celle-ci, « La nature est à considérer comme un système de degrés, dont chacun provient nécessairement du précédent, non cependant de telle manière que l’un serait naturellement engendré par l’autre, mais dans l’idée intérieure, celle qui constitue le fondement de la nature »[16] Si bien que « Hegel considère la nature comme une manifestation de l’« Idée » éternelle dans l’aliénation » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.207) (A voir)
Hegel était tombé dans l’illusion de concevoir la nature (le réel) “comme le produit de la pensée qui partant d’elle-même ; s’approfondit en elle-même et se meut pour soi » (Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Editions Sociales, p. 166). Cependant, ce processus de connexion universelle, anticipé par Hegel, n’a pu être compris complètement que par la conception matérialiste de la nature[17]. Selon celle-ci, le devenir de la nature, son mouvement, ses formes et ses contradictions ne peuvent être compris qu’à travers les lois de la dialectique dont les principales sont[18] : « (la) conversion de la quantité en qualité, - (la) pénétration réciproque des contraires polaires et conversion de l’un en l’autre quand ils sont poussés à l’extrême, - (le) développement par contradiction ou négation de la négation, - (la) forme spirale du développement. » (Engels, Dialectique de nature, Editions Sociales, p.25)
Dans une lettre à Marx en date du 14 juillet 1858, Engels s’étend sur les progrès considérables des sciences de la nature au cours des trente dernières années. Dans le cas de la physiologie, pour laquelle il souhaite vérifier si Hegel n’avait pas anticipé certains aspects des nouvelles découvertes, il met notamment en relief, le développement considérable de la chimie organique et tout particulièrement la découverte de la cellule. « On a obtenu grâce à ce dernier [le microscope NDR] des résultats encore plus importants que par la chimie ; mais ce qui principalement révolutionne toute la physiologie et rend enfin possible une physiologie comparée, c’est la découverte de la cellule, de la cellule végétale par Schleiden, de la cellule animale par Schwann (vers 1836). Tout est cellule. La cellule est l’être-en-soi hégélien. Son développement lui fait rigoureusement parcourir le procès hégélien : il en sort à la fin l’« Idée », l’organisme chaque fois entièrement achevé. » (Engels, Lettre à Marx, 14/07/1858, Lettre sur les sciences de la nature, Editions sociales, p.17)
2.2 La vie, la conscience sont des propriétés de la nature
Du point de vue matérialiste, il a bien fallu que l’organique naisse à partir de l’inorganique et inversement, que l’organique comme l’inorganique soient des formes de manifestation de la nature[19]. La différence entre les substances organiques et inorganiques réside dans le fait que les premières ont une composition chimique basée sur le carbone comme élément substantiel. C’est pour cela que la chimie organique[20] est aussi appelée chimie des composés du carbone. En leur sein, le carbone est combiné avec d’autres éléments comme l’hydrogène, l’oxygène, l’azote, etc. La diversité des substances organiques est déterminée par la structure chimique de ses éléments constitutifs. Et la matière organique est la médiation nécessaire pour que s’accomplisse le saut qualitatif de la matière inorganique au vivant.[21]
Engels était parfaitement conscient de cela tout comme des difficultés rencontrées pour y parvenir compte tenu d’une part, et en dépit des progrès importants qu’il signalait dans la lettre citée plus haut, du fait des limites de la connaissance et d’autre part du constat - sous-estimé[22] - que la nature connue avait mis des millions d’années pour parvenir à effectuer ce saut. Qui plus est, au-delà des réalisations de la chimie organique laquelle depuis la synthèse de l’urée avait pris un rang officiel parmi les branches de la chimie, ce qui était important était de fournir les bases du protoplasme, le contenu de la cellule.
Le mouvement est le mode d’existence de la matière et les diverses formes du mouvement supposent des différences qualitatives qui constituent autant de champs scientifiques[23]. Engels concluait que les sciences qui sont concernées par le mouvement de la vie n’étaient pas assez développées pour qu’il puisse se livrer à une étude approfondie des formes du mouvement organique[24]. Ces dernières, du fait de leur complexité, supposent, encore plus que pour les autres, la maîtrise de la pensée dialectique. Cet aspect explique, pour une part, le retard des sciences du monde organique par rapport aux autres sciences[25] ;. en même temps, pour autant que le développement des sciences puisse servir de marqueur du développement des forces productives et des évolutions de la production capitaliste, nous devons considérer que, du point de vue de son évolution comparée aux autres sciences, le capital est entré dans sa phase biologique, c’est-à-dire que cette science a atteint un tel essor qu’elle s’incorpore toujours plus au développement des forces productives et devient un facteur puissant qui vient s’associer et relayer les autres sciences dans la recherche du maximum de plus-value. Ces développements fournissent aussi les matériaux qui devraient permettre cette étude des formes du mouvement organique qu’Engels avait laissé de côté, gage d’un approfondissement de la pensée dialectique.
Pour Engels, « expliquer la naissance de la vie à partir de la nature inorganique (…) ne signifie pas autre chose que produire des albuminoïdes à l’aide de substances non organiques.” et “Dès que sera connue la composition des corps albuminoïdes, elle [la science, la chimie NDR] pourra procéder à la production de l’albumine vivante.” [un résultat] “que la nature elle-même ne réussit à réaliser que dans des circonstances très favorables, sur quelques corps célestes au bout de millions d’années.” (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.198)[26]
Toujours selon Engels : “Partout où nous rencontrons la vie, nous la trouvons liée à un corps albuminoïde, et partout où nous rencontrons un corps albuminoïde qui n’est pas en cours de décomposition, nous trouvons aussi, immanquablement, des phénomènes vitaux.” (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p.112)
Il est utile de rappeler ce qu’Engels entend par albumine et corps albuminoïdes : « On prend ici le corps albuminoïde au sens de la chimie moderne, qui rassemble sous ce nom tous les corps composés de façon analogue à l'albumine ordinaire, et appelés aussi substances protéiques. Le nom est maladroit, parce que, de toutes les substances qui lui sont apparentées, l'albumine ordinaire joue le rôle le moins vivant, le plus passif, étant, à côté du jaune d'œuf, uniquement substance nutritive pour le germe qui se développe. Cependant, tant qu'on n'en sait pas plus long sur la composition chimique des substances albuminoïdes, ce nom est encore le meilleur, parce que plus général que tous les autres. » (Engels, Anti-Dühring, p.51).
Engels connaissait donc le concept de protéine ou ses apparentements. Ce n’est pas étonnant puisque leur découverte date de 1835 par le Néerlandais Mulder, sous le nom de wortelstof, la matière racine. Son collègue suédois, Berzelius lui suggéra en 1838 d’employer le terme protéine, formé à partir du grec ancien protos, premier, essentiel[27]. Engels préférera en rester à un terme plus général pour désigner les composants de base du protoplasme.
Engels voit la naissance de la vie comme un chimisme poussé à son terme et par conséquent doté d’un saut qualitatif[28]. La synthèse dans la nature des substances organiques à la base de la vie était une condition préalable à l’apparition de la vie et leur synthèse par l’Homme la démonstration qu’il en avait bien été ainsi dans la nature. La philosophie des savants vitalistes qui pour certains visait à accorder la chimie et la bible[29] reculait puis sombrait devant les progrès de la synthèse des produits organiques[30]. Au-delà encore, pour Engels, l’aboutissement de ce processus devait être la reproduction de la vie en laboratoire.
Les travaux entrepris par la chimie organique pendant les XIXe et XXe siècles permirent de réaliser la synthèse de substances caractéristiques des organismes comme les sucres et les graisses, les pigments végétaux. Et au milieu du XXe siècle on synthétisa des corps complexes comme les vitamines, les antibiotiques ou les hormones et en ce début de XXI siècle, des avancées considérables dans le développement de la biochimie[31] ont été accomplis. Le deuxième quart du XXe siècle n’était pas entamé que le biochimiste russe Alexandre Oparine[32], émet l’hypothèse selon laquelle des molécules organiques ont pu se former par l’action du soleil, des éclairs et des volcans sur une atmosphère primitive disposant d’une composition particulière. A peine plus tard et indépendamment du premier, le biologiste J.B.S. Haldane[33] émet une théorie similaire. Au début du troisième quart du XXe siècle, Stanley Miller, un élève du chimiste Harold Urey, compose un dispositif formalisant la théorie de Oparine/Haldane et parvient à créer des composés organiques dont, dans une très faible proportion, des acides aminés primitifs. La chimie des molécules permettant l’émergence de la vie, la chimie prébiotique, disposait désormais d’une assise solide. Les protéines[34] étant une combinaison complexe d’acides aminés, la soupe primitive de Miller en était encore loin et tout laisse penser que la composition de l’atmosphère primitive ne correspondait pas à celle de l’expérience. Mais il était démontré que dans son propre mouvement la nature pouvait engendrer à partir de la nature inorganique des composants essentiels de la vie. Le chemin vers la reproduction de la vie n’en était pas pour autant complètement parcouru et les recherches en biologie ont montré que la complexité était bien plus grande que celle escomptée par Engels. Cependant de nombreux projets se donnent pour objectif, non seulement de reproduire la vie, qui du point de vue du marxisme précède la cellule (comme nous verrons dans la section 4.1), mais de produire une cellule artificielle, la vie du point de vue de la science mainstream, et un tel succès sera un nouveau triomphe de la pensée dialectique et on ne pourra que s’incliner devant les anticipations d’Engels[35].
Dans une perspective marxiste, la vie est une des propriétés de la nature, une de ses formes de manifestation. Elle est certes le résultat de la nature tout entière mais suppose l’existence de “conditions déterminées, données par tout l’enchaînement de la nature”. Dans son évolution elle conduit à la conscience d’elle-même dont l’Homme est une des manifestations.
« Jusqu'ici la science de la nature, et de même la philosophie, ont absolument négligé l’influence de l’activité de l’homme sur sa pensée. Elles ne connaissent d'un côté que la nature, de l’autre que la pensée. Or, c'est précisément la transformation de la nature par l’homme, et non la nature seule en tant que telle, qui est le fondement le plus essentiel et le plus direct de la pensée humaine, et l'intelligence de l’homme a grandi dans la mesure où il a appris à transformer la nature. C'est pourquoi, en soutenant que c'est exclusivement la nature qui agit sur l’homme, que ce sont exclusivement les conditions naturelles qui partout conditionnent son développement historique, la conception naturaliste de l'histoire - telle qu'elle se manifeste plus ou moins chez Draper et d'autres savants - est unilatérale et elle oublie que l’homme aussi réagit sur la nature, la transforme, se crée des conditions naturelles d'existence. » (Dialectique de la nature p.233)
La médiation entre l’homme et la nature s’accomplit à travers le processus de travail. Par le travail, l’homme agit sur la nature sensible extérieure, la transforme et transforme sa propre nature, mais « en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie aussi sa propre nature. Il développe les potentialités qui y sont en sommeil, et soumet à sa propre gouverne le jeu des forces qu'elle recèle. » (K I Sec. 3 Chap. V, PUF (4e Ed.) p. 199-200) Par cette action l’Homme domine la nature, c'est-à-dire qu'il modifie la forme du naturel et en même temps matérialise dans le naturel son propre objectif basé sur ses besoins en tant qu'espèce. Par ce mouvement de domination, il modifie le naturel selon sa propre volonté et il subordonne sa volonté au but de son propre travail à savoir produire les valeurs d'usage nécessaires et les forces productives matérielles qui constituent le contenu matériel de la richesse et le fondement matériel de sa propre existence en tant qu'espèce.
En résumé, l'action de l’Homme sur la nature est l'action de la nature sur elle-même. L’Homme, la société humaine, est la conscience de soi de la nature. Il déploie ses forces productives comme organes historiques et la nature est le fondement de son propre développement. La nature elle-même, transformée, augmentée, humanisée ne peut se maintenir et progresser que par l’action consciente qu’elle exerce sur elle-même par la médiation de l’esprit pensant dont l’Homme est une instance, une réalisation spécifique[36]. Il n'y a donc pas d'opposition en soi entre le développement des forces productives matérielles de la société humaine et la nature, comme le proclament les défenseurs malthusiens de l'ordre bourgeois régnant : les écologistes. Au contraire, ce processus de travail est une partie organique de la métamorphose et des changements de la nature. En prenant conscience d’elle-même s’ouvre le passage de l'histoire naturelle à l'histoire de l'humanité.
3. Conséquences imprévues de l’action de l’Homme sur la nature
Depuis ses origines, l’Homme est dans l’incapacité de contrôler le déchaînement des phénomènes naturels qui menacent sa vie. Au cours de son histoire, avec le développement des forces productives, de la technologie et de la science, l’Homme a dû se confronter avec la nature et se défendre collectivement contre ses changements imprévus[37].
3.1 Actions réciproques entre l’Homme et la nature
Tous les modes de production reposant sur la division de la société en classes sociales antagoniques ont connu des épidémies. Mais les sociétés de chasseurs cueilleurs avaient aussi des maladies infectieuses (rougeole, typhus, malaria, tuberculose transmise par les oiseaux, etc.). La contagion a été limitée du fait de l’isolement relatif des petites communautés. La situation va se modifier avec la période appelée néolithique.
Dès le néolithique, la domestication des animaux et de leur cohabitation avec l’espèce humaine modifie leur relation. La démographie humaine connaît une croissance importante, si bien que les accroissements de population du XXe et XXIe siècle ont été comparés à ceux de la « révolution néolithique ». L’accroissement de la productivité de l’agriculture permet la création de villes tandis que les différentiations sociales s’exacerbent et que des classes sociales aux intérêts antagoniques se forment. Les premières épidémies apparaissent alors. Quant à leurs effets, elles ont des répercussions jusqu’à nos jours en ayant sélectionné des individus plus aptes à faire face à des épidémies[38].
Des épidémies (étymologiquement « sur le peuple »), d’autres sociétés en ont connu. Vers la fin du Ve siècle avant JC, Thucydide relate, en écartant mythes et rumeurs, une épidémie dont il a failli mourir. Elle fera, de 430 à 426 avant JC, plusieurs dizaines de milliers de morts, dont Périclès, le stratège de la cité, à Athènes. Cela représentait un quart à un tiers de la population. Le mal débarque au Pirée, le port d’Athènes. La « peste d’Athènes » est, selon l’hypothèse la plus fréquemment retenue sur un sujet aussi délicat que les diagnostics rétrospectifs, une épidémie de typhus dont le vecteur est le pou.
Dans l’Empire romain, la « peste de Justinien » transmise, à l’origine, pour l’essentiel, par les puces, elles-mêmes contaminées par les rats venus d’Egypte[39], le grenier à blé de l’Empire, entraîne une pandémie qui, en plusieurs vagues, dure plus de deux siècles et ravage la population. Au printemps 542, 10 000 personnes meurent chaque jour à Constantinople qui perd autour de 40% de sa population. L’Empereur Justinien, malade, s’en tire à bon compte. Lors de l’hiver 589, à l’occasion d’une nouvelle poussée, la peste gagne Rome. Le pape Pélage II aura moins de chance que Justinien. Au début de l’ère chrétienne, on estime que Rome comptait plusieurs centaines de milliers d’habitants. Elle tombe à 20 000 habitants à la fin du VIe siècle.
A partir de 1347, venue d’Asie[40] et suivant les routes de la soie, la peste noire contamine, essentiellement par voie maritime, l’Europe médiévale. Des Génois contaminés (peut-être volontairement[41]) par des Tartares disséminent le bacile à Constantinople, Messine, Marseille. D’autres navires le diffusent dans tout le bassin méditerranéen. En 1348, l’Italie, l’Espagne, les vallées du Rhône et de la Garonne sont touchées. En quelques années, l’épidémie va ravager l’Europe. Les estimations les plus basses font état de la disparition du quart ou du tiers de la population européenne mais la documentation fiable qui permet d’estimer le nombre de décès reste insuffisante. Jean-Noël Biraben qui a étudié en détail l’histoire de la peste reste circonspect et ne parvient pas à donner une évaluation générale. Cette peste inaugure une nouvelle pandémie qui va durer plusieurs siècles. L’épidémie enjambe volontiers les classes sociales et les modes de production, même si ces aspects ne sont pas sans influence. Par exemple, pour ne citer que la France, Biraben, identifie vingt-six poussées principales et onze secondaires entrecoupées de trente-six rémissions. Les vagues les plus sévères ont lieu en 1348, 1361, 1374, 1400, 1412, 1439, 1482, 1502, 1522, 1531, 1545, 1564, 1586, 1596, 1626, 1636[42]. Une troisième pandémie, encore en cours[43], commence à la fin du XIXe siècle, elle touche Marseille en 1919, Paris (et Marseille) en 1920 où elle sera enrayée. Entretemps, Yersin a découvert le bacille de la peste et des sérums et vaccins ont été mis au point. Aujourd’hui ce sont surtout les antibiotiques qui permettent de combattre la peste, à condition d’y avoir accès ce qui n’est pas acquis dans les pays où subsistent des foyers épidémiques. Les vaccins ont une efficacité limitée dans le temps et ont potentiellement des effets secondaires qui en limitent l’usage. Enfin, ils ne permettent pas de prévenir la peste pulmonaire, très contagieuse et souvent mortelle. La régression relative de la peste rend ce marché du vaccin a priori peu rentable et décourage donc l’industrie du médicament d’y consacrer des recherches importantes[44].
Bien que les origines de la variole sur le continent soient discutées, elle a constitué pour les conquistadors espagnols une arme biologique qui va leur permettre de vaincre et d’anéantir la population de l’Empire Aztèque alors peuplé de 16 à 18 millions de personnes. Le sort des Aztèques sera partagé par les Mayas et les Incas.
Tout aussi intéressante est l’attitude des représentants des classes dirigeantes. Elle est identique à celle de notre bourgeoisie moderne. Quand elles ne fuient pas l’épidémie, les autorités d’une ville mènent expertises et enquêtes sur l’origine de la peste dès qu’elle est signalée. Mais l’information n’est pas diffusée pour ne pas nuire aux affaires et au ravitaillement ou créer une vague de panique. Les mesures de prévention, l’isolement, arrivent en retard et donc trop tard pour limiter la catastrophe. Les réactions pour lutter contre l’épidémie sont immédiates ; elles conjuguent magie, prières et processions qui favorisent l’épidémie, théories obscurantistes et millénarisme apocalyptique, théories « complotistes » (action d’individus malveillants), médicaments inadaptés et une organisation qui sera de plus en plus efficace. C’est avec le capitalisme et vraisemblablement l’affirmation de l’Etat nation et l’action concertée des Etats que l’organisation atteint son maximum d’efficacité. Elle conjugue le « dépistage » (billets de santé, une forme de passeport sanitaire personnel), l’édiction de règles d’organisation et d’isolement, le développement d’équipements hospitaliers assurant l’isolement des contagieux, la désinfection des rues, …
Cela n’empêche en rien la société bourgeoise de connaître des épidémies. Nous avons vu que la troisième pandémie de peste, toujours en cours, est contemporaine de la production capitaliste. La grippe espagnole ouvre une autre série d’épidémies dont la souche est le virus de la grippe. En trois vagues, dont la deuxième est la plus meurtrière, la grippe dite espagnole fera bien plus de morts que la première guerre mondiale dont plusieurs centaines de milliers en France[45]. Censure des autorités, affaiblissement du corps social du fait de la guerre impérialiste, absence de protections (un pourcentage élevé d’infirmières mourra) contribuent à l’hécatombe. La grippe asiatique de 1957 touchera 25% de la population mondiale et fera de 1 à 2 millions de morts. Etc.
Le pouvoir bolchévique aux prises avec la contre-révolution, la guerre civile, la famine connaîtra une épidémie de typhus qui aurait concerné 25 à 30 millions de personnes entre 1919 et 1921 et fait 2,5[46] millions (4 millions[47] ?) de victimes. Dans l’imagerie que se forge la bourgeoisie, le bolchévique juif est aussi un pouilleux, le spectre du communisme et de l’épidémie sont réunis. Comme pour l’antisémitisme[48], Churchill[49] est un héraut de la bourgeoisie occidentale.
Comme le montrent la Figure 1 et le Tableau 1, la domination du mode de production capitaliste moderne s’est accompagnée d’une augmentation considérable de la population.
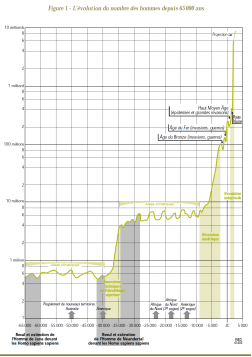
Figure 1 (Jean-Noël Biraben, l’évolution du nombre des hommes, Population et sociétés, n°394, 2003)
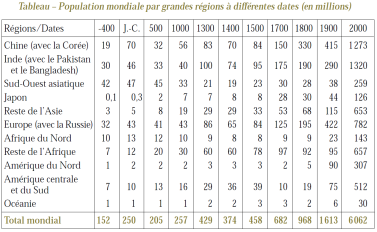
Tableau 1 (Idem)
Avec des hauts et des bas (notamment la deuxième moitié du XIXe siècle), la mortalité infantile a reculé et l’espérance de vie a augmenté surtout à partir du XXe siècle, notamment grâce à la vaccination, les mesures d’hygiène et leur intégration dans les pratiques quotidiennes, les politiques de santé publique, l’amélioration de la qualité de l’eau (cf. la Figure 2). La découverte des antibiotiques, dans l’entre-deux guerre, à elle-seule, a permis une augmentation de l’espérance de vie de 10 ans. Le vaccin de la variole, a permis, au début du XIXe siècle un recul de la mortalité infantile, puis d’autres facteurs ont permis une évolution favorable de celle-ci.
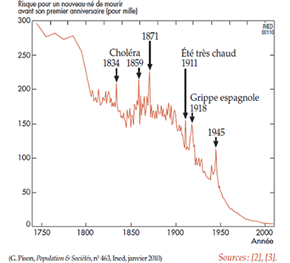
Figure 2 – Evolution de la mortalité infantile en France de 1740 à 2009.
Tout cela nous montre que les progrès des connaissances scientifiques sont tels qu’il est possible de faire régresser considérablement la mortalité et la mortalité infantile en particulier laquelle reste encore, comparativement, très élevée dans certaines régions. La bourgeoisie qui dirige la société continue de la réformer mais, prise dans ses contradictions, elle se montre incapable de mener une politique rationnelle sur ces sujets comme sur d’autres ; l’épisode de la récente pandémie de coronavirus est à nouveau là pour en témoigner.
C’est aussi que les effets second ou troisième de l’action humaine sur la nature dans les sociétés de classes rencontrent des limites et en particulier dans la société bourgeoise ; jamais les capacités d’analyse, de prévision et de prévention n’ont été aussi développées et jamais elles n’ont conduit à une telle faillite qui aboutit à la fois à une catastrophe sanitaire et à une paralysie de l’activité économique à un degré jamais atteint. Une nouvelle fois la bourgeoisie démontre à la fois que la société n’a jamais été aussi développée et qu’elle est incapable de la diriger sans la précipiter régulièrement dans l’abîme.
Dans l’analyse des facteurs qui favorisent ces épidémies, il faut se garder d’arguments à l’emporte-pièce qui n’ont d’excuse que la haine contre la société bourgeoise. Nous avons montré que toutes les sociétés connaissaient des maladies contagieuses, que toutes les sociétés de classe connaissaient des épidémies et que si dans les sociétés primitives elles n’ont pas dû aller au-delà de quelques communautés c’est à cause de leur isolement relatif. Cet isolement ayant disparu, il serait absurde de nier qu’une société sans classes serait à l’abri d’une épidémie, comme si le communisme serait une société sans virus, sans bactéries, sans parasites, sans champignons, sans protozoaires. Les virus sont un facteur essentiel de la vie ; un pourcentage non négligeable du génome de l’Homme moderne provient d’un virus ; le corps porte autant sinon plus de bactéries et de virus qu’il n’a de cellules ; les virus voyagent par milliards dans l’atmosphère et il y en a plusieurs centaines de millions au mètre carré. S’il y en a qui sont pathogènes, d’autres contribuent à la vie de l’Homme en détruisant par exemple certaines bactéries. Le virus qui est à la frontière du vivant tout en étant une composante essentielle, oblige à avoir une pensée dialectique ; il semble qu’ils sont nombreux à l’avoir oublié.
Les gouvernements n’ont pas décidé d’arrêter, après moultes atermoiements, une bonne partie de la production parce que la vie du prolétariat est une priorité ; nous verrons qu’ils sont allègrement sacrifiés si nécessaire. Ce n’est pas tant le nombre de morts, encore que leur concentration puisse rendre la gestion de la crise plus difficile, mais plutôt les modalités de leur mort dès lors qu’ils meurent à l’hôpital et plus encore, le nombre potentiel, bien plus important, des personnes nécessitant des soins intensifs de réanimation sur une longue durée sans pour autant décéder qui ont poussé à prendre cette décision. La menace d’un chaos sanitaire non seulement en raison de l’épidémie mais aussi des effets de bord sur le système hospitalier du fait des besoins récurrents, ont conduit les gouvernements des pays les moins bien préparés[50] à affronter une telle pandémie, la première qui ne soit pas issue du virus de la grippe[51], à confiner la population. Par la même occasion, on avait là un excellent sujet de diversion pour toutes les questions sociales qui travaillent la société. Fini les manifestations, fini la contestation des lois liberticides et anti-prolétariennes !
Comme toujours, en dernière analyse, les mesures et les lois votées par la bourgeoisie, quelle que soit leur intention primitive se retournent contre le prolétariat et viennent renforcer sa domination. Bien que le contexte soit différent, nous ne doutons pas un instant de ce que l’Etat d’urgence sanitaire, promulgué lors des situations qui notamment débordent les systèmes hospitaliers, soit l’occasion pour la bourgeoisie de raffiner ses méthodes de domination : confiner la population, imposer des couvre-feux, restreindre les libertés (notamment de réunion, de manifestation), mettre en place et tester de nouveaux modes de contrôle et de surveillance des populations (géolocalisation, extension de la vidéo surveillance, drones, reconnaissance faciale, contrôle des déplacements, …), évaluer les réactions du prolétariat, peaufiner l’arsenal répressif, faire avaler au prolétariat un ensemble de lois anti-sociales et dégrader sa situation en reprenant ce qu’elle a pu concéder. En France, par exemple, l’Etat d’urgence « anti-terroriste » s’était conclu par l’introduction dans la loi ordinaire de mesures qui relevaient auparavant de cet état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire permettra d’ajouter une dimension supplémentaire à l’arsenal juridique pour assurer la domination de l’ordre bourgeois. Ces nouvelles mesures permettront pour de bonnes et de mauvaises raisons de décider de confiner quand il plaira au pouvoir en place.
3.2 La bourgeoisie continue de réformer la société
Le marxisme ne nie pas non plus que la bourgeoisie continue de réformer la société alors qu’elle n’a plus, depuis longtemps, ni la légitimité historique ni la capacité à la diriger rationnellement. En 1909 le grand marxiste Anton Pannekoek illustrait, dans un article intitulé « La destruction de la Nature », le point de vue fondamental du marxisme à savoir que le mode de production capitaliste moderne épuisait les deux seules sources de la richesse : la terre et le travailleur[52]. Dans ce texte, il évoque notamment « un massacre d’oiseaux de Paradis », en Nouvelle-Guinée, alors chassés pour orner les chapeaux de dames. Dans la partie de la Nouvelle-Guinée contrôlée par les Pays-Bas, la chasse aux oiseaux de Paradis sera interdite en 1931. La chasse ne menace plus ces espèces. Parmi ces oiseaux de Paradis, certains exhibent lors des parades amoureuses, un noir intense qui rivalise avec le noir le plus noir produit par l’Homme. L’analyse microscopique de ces plumes a montré que c’était leur structure, des nano cavités qui emprisonnent la lumière, qui permettait un tel résultat. « Cette structure naturelle pourrait inspirer des modistes ou des fabricants d'optiques pour concevoir de nouveaux matériaux, lunettes solaires ou télescopes.[53]». Le processus dialectique : humanisation de la nature ; l’Homme protège et organise l’existence des oiseaux de Paradis et naturalisation de l’Homme ; l’Homme maîtrise pour ses propres fins des caractéristiques de la nature dont il ne disposait pas, se poursuit. Le fait qu’il s’accomplisse dans le cadre du mode de production capitaliste fait peser une menace permanente sur les deux composantes, provoque régulièrement des catastrophes qui obligent la classe dirigeante à réagir quitte à violer ses propres principes. C’est ce qui s’est passé, avec l’autre sujet abordé par Pannekoek : la déforestation et les inondations dans les Alpes françaises[54].
Dans un rapport présenté en 1965, P. Fourchy retrace la lutte contre l’érosion au XIXe siècle dans les Alpes françaises. Le texte commence par indiquer pourquoi il est très difficile de se faire une idée précise de la situation forestière des Alpes avant le XIXe siècle, la couverture administrative délaissant les zones montagneuses et nombre de documents aboutissent à des déclarations contradictoires selon leur destination. Même pour certains des documents émanant des fonctionnaires spécialisés, il existe des insuffisances[55]. Toujours est-il que si on estime que la forêt française a atteint un périgée au tournant du XIXe siècle (6 à 7 millions d’ha) et donc notamment suite à la prise de pouvoir de la bourgeoisie française et à la déforestation dénoncée par Pannekoek, celle-ci n’a cessé de reboiser[56]. Au moment où Pannekoek écrivait, on en était rendu à plus de 9 millions d’ha et aujourd’hui ce sont 17 millions d’ha qui sont couverts par les forêts (notamment du fait du développement de la productivité agricole et du développement des friches agricoles qui l’accompagne), soit près du 1/3 du territoire métropolitain et un niveau de boisement similaire à celui de la fin du Moyen-Âge. La France est devenue exportatrice nette de bois bruts au point où c’est la seule catégorie (avec la tonnellerie dont elle est le premier producteur mondial) de la « filière bois » qui présente un solde du commerce extérieur positif. Cela ne va pas sans la grogne des acteurs aval de la filière, en particulier les scieurs, qui réclament des mesures protectionnistes pour ne pas être privés de bois[57].
Les inondations cependant continuent. Elles n’ont plus seulement un lien direct avec la déforestation bien que des voix puissent critiquer le choix des espèces qui sont plantées en regard de leur capacité à retenir l’eau ou fixer la terre, celles-ci étant sacrifiées au profit d’espèces permettant une rotation du capital plus rapide. Le mal ne part plus uniquement de la périphérie mais du centre, avec l’accroissement de la pression foncière et l’augmentation de la rente qui l’accompagne. L’expansion des superficies urbanisées y compris celles qui sont inondables, empêche l’infiltration des eaux dans la terre, tandis que les cours d’eaux traversant les villages font l’objet d’une gestion minimale. Lors des crues, ils charrient volontiers des « matériaux solides », euphémisme pour désigner une conséquence de la reforestation (arbres morts ou déracinés notamment) ou des déchets en tout genre qui seront autant de béliers, d’obturateurs ou d’obstacles favorisant l’aggravation de l’inondation.
Dans « La dialectique dans la nature », Engels prend soin de montrer que le mode production capitaliste n’a pas l’exclusivité des conséquences plus ou moins catastrophiques de l’action des hommes sur la nature, mais il montre que ce mode de production porte à leur comble des tendances fort anciennes[58].
« Bref, l'animal utilise seulement la nature extérieure et provoque en elle des modifications par sa seule présence ; par les changements qu'il y apporte, l’Homme l'amène à servir à ses fins, il la domine. Et c'est en cela que consiste la dernière différence essentielle entre l’Homme et le reste des animaux, et cette différence, c'est encore une fois au travail que l’Homme la doit.
Cependant ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune d'elles. Chaque victoire a certes en premier lieu les conséquences que nous avons escomptées, mais, en second et en troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ces premières conséquences. Les gens qui, en Mésopotamie, en Grèce, en Asie Mineure et autres lieux essartaient les forêts pour gagner de la terre arable, étaient loin de s'attendre à jeter par-là les bases de l'actuelle désolation de ces pays, en détruisant avec les forêts les centres d'accumulation et de conservation de l'humidité. Sur le versant sud des Alpes, les montagnards italiens qui saccageaient les forêts de sapins, conservées avec tant de sollicitude sur le versant nord, n'avaient pas idée qu'ils sapaient par-là l'élevage de haute montagne sur leur territoire ; ils soupçonnaient moins encore que, par cette pratique, ils privaient d'eau leurs sources de montagne pendant la plus grande partie de l'année et que celles-ci, à la saison des pluies, allaient déverser sur la plaine des torrents d'autant plus furieux. (…). Et ainsi les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que toute notre domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures de connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement. (…)
Mais s'il a déjà fallu le travail de millénaires, pour que nous apprenions dans une certaine mesure à calculer les effets naturels lointains de nos actions visant la production, ce fut bien plus difficile encore en ce qui concerne les conséquences sociales lointaines de ces actions. (…)
Mais, même dans ce domaine, nous apprenons peu à peu, au prix d'une longue et souvent dure expérience et grâce à la confrontation et à l'étude des matériaux historiques, à élucider les conséquences sociales indirectes et lointaines de notre activité productive et, de ce fait, la possibilité nous est donnée de dominer et de régler ces conséquences aussi.
Mais, pour mener à bien cette réglementation, il faut plus que la seule connaissance. Il faut un bouleversement complet de tout notre mode de production passé et, avec lui, de tout notre régime social actuel.
Tous les modes de production passés n'ont visé qu'à atteindre l'effet utile le plus proche, le plus immédiat du travail. On laissait entièrement de côté les conséquences lointaines, celles qui n'intervenaient que par la suite, qui n'entraient en jeu que du fait de la répétition et de l'accumulation progressives. (…)
Toutes les formes de production supérieures [après la dissolution des communautés primitives NDR] ont abouti à séparer la population en classes différentes et, par suite, à opposer classes dominantes et classes opprimées ; mais en même temps l'intérêt de la classe dominante est devenu l'élément moteur de la production, dans la mesure où celle-ci ne se limitait pas à entretenir de la façon la plus précaire l'existence des opprimés. C'est le mode de production capitaliste régnant actuellement en Europe occidentale qui réalise le plus complètement cette fin. Les capitalistes individuels qui dominent la production et l'échange ne peuvent se soucier que de l'effet utile le plus immédiat de leur action. Et même cet effet utile, - dans la mesure où il s'agit de l'usage de l'article produit ou échangé, - passe entièrement au second plan ; le profit à réaliser par la vente devient le seul moteur. » (Engels, Dialectique de la nature, Editions Sociales, pp. 181-182)
Ce n’est que dans le communisme que l’on pourra dépasser certaines limites, mais cela n’en fait pas une société qui prévoira toutes les conséquences de ses actes, ne serait-ce que parce qu’elle innovera.
4. Virus et dialectique
Comme nous l’avons vu dans la section 2, l'humanité connaît des maladies virales depuis des millénaires et, face à un fléau épidémique, cette humanité n'attendit pas l'autorité indubitable d'une démonstration scientifique pour tenter d'y remédier avec une relative efficacité. Par exemple, la vaccination contre la variole[59] - « la variolisation » comme l'appelèrent les occidentaux en l'important d'Orient au XVIIIe siècle - était une pratique courante en Inde et en Chine au moins depuis le XIe siècle.
Tout cela pour dire que bien que côtoyant l'univers des virus depuis des lustres les sociétés humaines n'en comprennent véritablement l'alphabet que depuis peu car l’émergence de la génétique, une des sciences fondamentales du vivant, en était la condition indispensable.
4.1 Les virus et la dialectique, le vivant et les origines de la vie
Les découvertes du rôle des virus dans l’évolution, comme la reconnaissance qu’en dépit de leur étymologie[60] (poison, toxine) ils étaient loin d’être tous pathogènes pour l’Homme, ont induit l’hypothèse que les virus précéderaient l’émergence du vivant. Comme, actuellement, les virus se caractérisent par leur interaction et leur interpénétration avec le vivant (assimilé à la cellule), cette hypothèse suppose qu’auparavant ces virus, qu’on les nomme ainsi ou autrement, avaient des modalités de reproduction[61] (réplication[62], recopie, comme on voudra) autonomes. D’autre part, comme ces protovirus n’ont pas été identifiés, on doit également supposer qu’ils ont perdu ces propriétés avec la complexification du vivant. Cette thèse, pour une part, s’oppose aussi à celle qui voit les virus, comme un produit ou un sous-produit, car il n’en aurait pas toutes les caractéristiques, du vivant[63]. D’un autre côté, la perspective d’une apparition de la vie à partir du mouvement de la matière organique non vivante, repose, sur un autre plan et d’une autre manière, la question de la génération spontanée qui a été chassée du domaine du vivant notamment par Pasteur.
La vie, dans la conception traditionnelle moderne dominante, bien que faisant l’objet de nombreux débats[64], est assimilée à la cellule et à son organisation, notamment, le métabolisme, la compartimentation, la reproduction, l’évolution.
Cette représentation n’était en rien celle de Marx et Engels pour qui la vie commençait avant la cellule. Ce n’est pas que la découverte de celle-ci ait été sous-estimée. Bien au contraire, Engels la classe parmi les trois grandes découvertes qui ont balayé l’approche de la nature propre au matérialisme métaphysique et permis la constitution des sciences de la nature en un « système de connaissance matérialiste de la nature. »[65]
Pour Marx et Engels, il ne faisait guère de doute que l’organique et le vivant, cette part particulière de l’organique, étaient le résultat d’un chimisme poussé jusqu’au bout (cf. section 2.1), ce qui, en bonne dialectique, suppose des sauts qualitatifs. Un premier saut avait été réalisé avec la synthèse de matières organiques, un autre saut le serait avec la synthèse de la matière bio-organique à la base du protoplasme. Cette analyse avait au moins deux conséquences : la matière du protoplasme était homogène et une fois synthétisée de manière indépendante, elle contenait déjà des caractéristiques suffisantes pour relever du vivant[66]. Par conséquent, la vie précédait l’existence de la cellule et donc ne commençait pas avec celle-ci. Dans la représentation d’Engels, la synthèse du protoplasme, assimilé au monde des bioprotéines, des albumines, serait la synthèse de la vie en laboratoire. Marx et Engels partageaient la même vision[67] mais peu avant sa mort, Marx pensait que la synthèse chimique était proche[68]. Après la mort de Marx, Engels repoussait à bien plus loin la réalisation[69] d’une synthèse qui n’allait pas de soi[70]. Notons qu’un Haldane, par exemple, au siècle suivant, allongera encore le délai de réalisation d’une telle synthèse[71]. Pour Engels, l’albumine vivante, non différenciée, était le point de passage vers la cellule[72].
Dans l’état de la science de l’époque, il ne pouvait en être autrement pour qui avait un point de vue matérialiste. La reconnaissance de l’acide nucléique comme support de l’information héréditaire n’interviendra qu’au cours du XXe siècle. Sous le nom du nucléine, l’ADN avait pourtant été découvert en 1869 (publication en 1871) mais son inventeur, le Suisse Friedrich Miescher, accumulera au contraire les preuves pour écarter son rôle dans l’hérédité[73]. La première mention des chromosomes date de 1882 ; le terme lui-même date de 1888[74]. Walther Flemming, à l’origine de la découverte, ne réussira pas à faire le lien avec l’hérédité. Ils ne vont par paires que depuis 1902 (Sutton). Encore théorique, en 1902, quand Sutton et Boveri, indépendamment l’un de l’autre, pensent que les chromosomes seraient porteurs du matériel génétique, il faut attendre 1915 pour en avoir une démonstration plus complète grâce aux travaux de Thomas Hunt Morgan[75]. Le terme de gène date de 1909. En 1928, les expériences de Frederick Griffith mettent en évidence l’existence d’un message héréditaire. Il restait encore à démontrer qui de l’ADN ou des protéines est le support de l’information génétique. Dans les années 1940 (publication en 1944), trois chercheurs, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarty, fournissent la preuve que le support du matériel génétique des cellules est l’ADN.
.
On notera également que pour Marx et Engels, la cellule dispose d’un noyau. Il faudra attendre les années 1950 et leur pleine observation au microscope électronique pour qu’apparaisse le concept de procaryote, de cellule sans noyau, un type de cellule précédent même l’apparition des cellules eucaryotes, des cellules avec un noyau.
Quant aux virus, ils sont découverts scientifiquement après la mort d’Engels – 1898[76] - et le monde des virus et de ses singularités ne commence qu'à peine à être scientifiquement cerné. On pourrait dire, pour n'en rester qu'au plan de la biologie, que si le XXe siècle a été celui des découvertes et des traitements bactériologiques celui du XXIe pourrait bien être celui de la virologie.
Relevons quelques étapes qui mènent au concept de virus dans son acception dominante :
· Wendell Stanley, en 1935, parvient à cristalliser la mosaïque du tabac. L’analyse chimique qui s’ensuit relève qu’il s’agit d’une structure composée de protéines et d’acide ribonucléique (ARN). Par ailleurs, la découverte de virus infectant les bactéries (1915), dénommés bactériophages, aboutit en 1934 (Max Schlesinger) à une analyse qui les décrit comme une combinaison de protéines et d’acide désoxyribonucléique (ADN)[77]
· Pour observer de si petites entités, il fallait que soit inventé le microscope électronique. Le premier prototype sera créé en 1931 en Allemagne[78]. C’est en Allemagne qu’il sera également perfectionné jusqu’en 1940[79]. Sa première utilisation pour l’étude des virus date de 1939 (Kausche et al.)[80]. La première observation d’un coronavirus date des années 1960 (la première photo publiée date de 1967[81]), le virus de la rage ne sera visualisé qu’en 1962[82], le virus de l’hépatite C en 2016[83], …
· En 1955, des particules du virus de la mosaïque du tabac sont reconstituées à partir d’un ARN purifié et de ses composants protéiniques[84]. L’année suivante, il est montré que seul l’ARN est responsable de l’infectivité du virus[85]. L’information génétique n’était pas propre à l’ADN mais relevait des propriétés des acides nucléiques. Avec la découverte de la structure de l’ADN en 1953, on pouvait poser les bases des principes essentiels mais aussi les dogmes de la virologie scientifique.
· Une partie de ceux-ci seront mis à mal avec la découverte de la transcriptase inverse, une enzyme permettant de transcrire l’ARN en ADN[86].
Le concept moderne de virus sera introduit par André Lwoff en 1957. Il en fait une entité distincte des micro-organismes (un seul acide nucléique ARN ou ADN mais pas les deux comme dans une cellule ; différence dans le mode de reproduction/réplication – le virus utilise uniquement son acide nucléique ; pas de « croissance » et de fission binaire ; absence de métabolisme – absence de système de Lipmann[87]).
Bien qu’il reste prisonnier d’un certain matérialisme vulgaire, la définition de Lwoff est extrêmement puissante, un modèle de pensée dialectique. Son analyse constitue un formidable saut qualitatif dans l’histoire du concept de virus. En effet, au-delà de tous les arguments analytiques qui caractérisent le virus et qui sont souvent ce qui est uniquement retenu ou mis en avant dans son analyse, Lwoff comprend le virus comme un processus, comme un cycle complet.
Quiconque s’est confronté au concept de capital chez Marx et y aura compris qu’il s’agit de la valeur d’échange engagée dans un procès, un processus à travers lequel elle revêt plusieurs formes pour revenir à la forme théorique de départ[88], ne peut qu’être frappé par la vision de Lwoff. Dans son acception, le virus est donc un concept qui recouvre le cycle complet, cycle qui comprend la particule virale, baptisée par la même occasion virion pour la distinguer du virus-ensemble du cycle et qui donc ne doit plus être assimilé à la seule particule virale, le prophage (c’est-à-dire le génome du bactériophage – les virus qui infectent les bactéries) dans son état latent, le prophage inséré dans l’ADN de la cellule, le processus pour recréer de nouveaux virions en exploitant la machinerie cellulaire, jusqu’aux nouveaux virions à l’extérieur de la cellule, à nouveau prêts pour un nouveau cycle. Ajoutons que ce processus n’est pas propre à toutes les cellules infectées puisque dans certains cas, la cellule se reproduit tout en conservant l’ADN modifié par le bactériophage qui mettra en branle le processus de création de nouveaux virions lors de générations ultérieures de la bactérie.
Cette définition conduit à montrer la spécificité des virus[89] et à les mettre à côté du vivant sans qu’ils en fassent partie. Depuis 1957, de nombreuses découvertes sont venues questionner le concept établi par Lwoff. Bien qu’on puisse soutenir qu’il soit toujours opérant, l’obligation de traiter sa relation au vivant[90] dialectiquement, à l’instar d’ailleurs de ce que fit Lwoff pour le cycle du virus, est toujours plus impérieuse.
Les biologistes contemporains qui se prononcent peuvent être classés en cinq grandes catégories : ceux pour qui les virus appartiennent au monde du vivant, ceux pour qui les virus relèvent du non-vivant, ceux pour qui ils sont dans une situation intermédiaire, ceux pour qui la réponse dépend de la définition de la vie et du vivant sous ses diverses formes, et enfin ceux qui pensent que cette question ne relève pas de la science mais de la philosophie ou de la métaphysique[91].
En ce qui concerne les derniers cités, il y a longtemps que le marxisme a réfuté cette attitude et montré en quoi elle ne faisait que s’aligner sur les plus mauvaises idéologies[92].
« Les savants croient se libérer de la philosophie en l'ignorant ou en la vitupérant. Mais, comme, sans pensée, ils ne progressent pas d'un pas et que, pour penser, ils ont besoin de catégories logiques, comme, d'autre part, ils prennent ces catégories, sans en faire la critique, soit dans la conscience commune des gens soi-disant cultivés, conscience qui est dominée par des restes de philosophies depuis longtemps périmées, soit dans les bribes de philosophie recueillies dans les cours obligatoires de l'université (ce qui représente non seulement des vues fragmentaires, mais aussi un pêle-mêle des opinions de gens appartenant aux écoles les plus diverses et la plupart du temps les plus mauvaises), soit encore dans la lecture désordonnée et sans critique de productions philosophiques de toute espèce, ils n'en sont pas moins sous le joug de la philosophie, et la plupart du temps, hélas, de la plus mauvaise. Ceux qui vitupèrent le plus la philosophie sont précisément esclaves des pires restes vulgarisés des pires doctrines philosophiques. » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.211)
« Les savants ont beau faire, ils sont dominés par la philosophie. La question est seulement de savoir s'ils veulent être dominés par quelque mauvaise philosophie à la mode, ou s'ils veulent se laisser guider par une forme de pensée théorique qui repose sur la connaissance de l'histoire de la pensée et de ses acquisitions.
Physique, garde-toi de la métaphysique ! c'est tout à fait juste, mais dans un autre sens.
Les savants gardent à la philosophie un reste de vie factice en tirant parti des déchets de l'ancienne métaphysique. Ce n'est que lorsque la science de la nature et de l'histoire aura assimilé la dialectique que tout le bric-à-brac philosophique, - à l'exception de la pure théorie de la pensée, - deviendra superflu et se perdra dans la science positive » (Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, p.211)
Les divers points de vue des biologistes ne font que répondre unilatéralement à cette question dont la réponse dialectique devant un sujet aussi complexe est celle que faisait Hegel[93] à propos de la continuité ou de la discontinuité de la matière : l’un et l’autre (à la fois vivant et non-vivant) et ni l’un, ni l’autre (ni vivant, ni non-vivant – intermédiaire entre les deux).
Définir, conceptualiser n’est pas poser une frontière strictement délimitée car nous savons qu’il n’existe pas de « hard and fast lines » entre les concepts et que, d’autre part, un concept évolue[94]. Il progresse tout particulièrement à travers des sauts qualitatifs.
Si la vie précède la cellule, nous avons donc une définition de la vie qui est différente de celle de Lwoff[95]. Il faudrait cependant établir que la matière organique de type acide nucléique avait les propriétés, ou du moins nombre d’entre elles, dont Engels parait l’albumine (protéines): « digestion, élimination, mouvement, contraction, réaction aux excitations, reproduction. »
Des découvertes importantes autour de l’ARN ont conforté cette hypothèse. Dans les années 1980, Tom Cech et Sydney Altman, découvrent les ribozymes (mot formé à partir de la contraction et de l’association de ribonucléique – le RN de ARN -et d’enzyme) qui ont la propriété de catalyser des réactions chimiques, rôle jusque-là dévolu aux seules protéines. Pour cette découverte des propriétés catalytiques de l’ARN, ils obtiendront le prix Nobel de chimie en 1989. En y ajoutant la découverte de la transcriptase inverse, qui permet d’obtenir de l’ADN à partir de l’ARN, l’ARN, de structure plus simple et aussi plus instable que l’ADN, devient un candidat plausible pour l’origine de la vie. Les propriétés catalytiques de l’ARN permettent une réplication plus ou moins complète d’autres brins d’ARN, ce qui dans une certaine mesure répond à la question de la reproduction sachant que par ailleurs l’ARN est porteur de l’information génétique. Dans la mesure où l’ARN porte, transmet et duplique l’information génétique et dispose des capacités catalytiques similaires aux enzymes, la possibilité d’un métabolisme primitif est alors ouverte.
La découverte que la vie existait dans des conditions extrêmes de pression et de température près des sources hydrothermales des fonds marins a conduit Robert Hazen à renouveler l’expérience de Miller et Urey en l’adaptant aux conditions propres aux fonds marins. L’expérience ne donnera des résultats que lorsque des minéraux seront ajoutés à la « soupe primordiale »[96]. La séparation rigide entre le monde minéral et organique, déjà entamée depuis longtemps, s’évanouissait un peu plus tandis qu’il montrait que si le monde minéral était une composante de l’origine de la vie on devait reconnaître également qu’une majorité des minéraux actuels[97] étaient le résultat de l’action de la vie sur la nature. D’un autre côté, la complexité croissante des organismes devait beaucoup aux minéraux (carapaces, dents, os, …). La dialectique remportait une nouvelle victoire[98].
La synthèse en laboratoire, à partir de matière organique, de molécules bio-organiques dont l’acide nucléique est devenu une réalité. En 2009, le laboratoire de John Sutherland, à partir d’une soupe primordiale, une soupe prébiotique, fait apparaître spontanément de l’ARN. En 2015, le même laboratoire, toujours à partir d’un ensemble de molécules inanimées ont produit non seulement des acides aminés mais toutes les composantes propres à la cellule, à savoir les nucléotides à la base de l’ADN, des acides aminés et des sucres ainsi que des composants précurseurs de la membrane cellulaire[99]. La création simultanée de l’ensemble des briques de la vie répondait à la question de l’antériorité de telle ou telle composante.
Le monde de l’ARN avec la création d’un vaccin contre le coronavirus a remporté une nouvelle victoire, transformant des chercheurs parias en nobélisables[100].
Le passage d’un organisme qui relèverait du vivant[101], au virus, vu comme une trace de l’évolution de cet organisme qui en même temps aurait perdu son autonomie supposerait que l’ARN, s’il est à l’origine du vivant, puisse se répliquer par lui-même. Parallèlement mais en symbiose avec le mode viral, l’autonomie serait devenue l’apanage de la cellule ; qui donc représenterait une évolution plus complexe de cet organisme. Dans ce processus de développement, comme nous le montrons tout au long de ce chapitre, le matériel génétique de l’organisme[102] « inerte » est une composante nécessaire du développement de l’organisme doué de métabolisme. Sa réciproque n’est en rien exclue ; elle en est le pendant dialectique en quête de démonstration. D’autre part, au-delà des questions propres au « monde de l’ARN » et outre les modifications apportées dans les gènes des cellules par les virus, des auteurs comme Joseph Reicholf[103] évoquent l'origine probable des cellules les plus évoluées, les cellules avec un noyau par une coopération entre un virus et un organisme procaryote (ne possédant pas de noyau). Le virus en question apportant à la cellule son noyau justement et la transformant alors en organisme eucaryote. Cette approche n’est pas exclusive de celle qui voit la création du noyau ou des organites de la cellule par l’absorption d’une autre cellule. Lorsqu'on voit en effet la complexité du métabolisme cellulaire et les rapports entre noyau et cytoplasme, et enfin entre ce véritable petit univers et les contraintes environnementales qu'ont eu à passer ces premiers organismes vivants, on ne peut que supposer que les virus ont joué un grand rôle dans cette évolution.
Il existe aujourd’hui des particules virales, découvertes dans les années 1960, nommées viroïdes qui ne sont constituées que d’un seul brin circulaire d’ARN. Leur génome est réduit ; les viroïdes sont plus petits que les virus. Comme ils n’ont pas d’enveloppe et qu’ils ne codent pas de protéine, ils sont distingués des virus proprement dit tout en étant classés dans le même monde. Comme les virus, ils dépendent de la cellule pour se reproduire. De même, il existe des virusoïdes qui sont également constitués par un brin d’ARN mais qui sont considérés comme des satellites des virus, car ils dépendent de ces derniers (phytovirus) pour se répliquer et constituer leur enveloppe (capside).
Dans les viroïdes qui ne se répliquent pas dans le noyau (les cellules à noyaux étant par ailleurs un stade supérieur de l’organisation du vivant), mais dans un organe des plantes appelé chloroplaste, il a été mis en évidence des séquences d’ARN à activité autocatalytique[104]. Or, l’autocatalyse qui joue sur la position des atomes (phénomène que l’on rencontre par exemple dans les cristaux) dans les molécules et sur leur capacité à attirer, dans certains cas, d’autres atomes pour former des combinaisons qui se reproduisent, est une perspective plausible pour expliquer une reproduction en dehors de la cellule. Une reproduction, réplication ou un autre nom (production de novo) que l’on voudra de l’ARN par autocatalyse constituerait donc un argument de poids pour faire de ces organismes des protovirus et des protocellules[105] disparus depuis longtemps.
Sur le chemin de la vie, la synthèse de la matière minérale a été réalisée, puis celle de la matière organique (XIXe siècle : synthèse de l’urée - 1828 - pour retenir une date mais auparavant le même Wöhler a réalisé la synthèse de l’acide oxalique), puis celle de la matière bio-organique (XXe siècle : soupe primordiale et création d’acides aminés - 1950). Depuis encore, d’autres progrès que nous avons brièvement retracés ont permis des avancées qui laissent penser qu’un chimisme poussé jusqu’au bout a permis l’émergence de la vie. La discussion sur les conditions présumées qui régnaient sur la terre, il y plusieurs milliards d’années et qui ont permis l’émergence de la vie et dont on pointe les différences par rapport aux conditions expérimentales des diverses soupes prébiotiques, comme l’analyse des météorites ont conduit à des hypothèses sur l’origine extra-terrestre de la vie. La proposition n’est pas nouvelle. Elle agaçait Marx, non pas tant à cause de l’hypothèse scientifique, que de sa dimension dilatoire et d’éventuels relents créationnistes qui freineraient une recherche matérialiste[106].
Bien qu’ils soient placés en dehors ou à la frontière de la vie, l’étude des virus a joué un rôle déterminant dans la compréhension et la démonstration que les acides nucléiques étaient les porteurs de l’information génétique[107]
La classification du vivant qui domine actuellement la théorie biologique, même si elle se limite à la vie terrestre, n’inclut pas dans sa définition du vivant l'univers des virus. Quelles sont les différences qui conduisent à des débats où nous reconnaissons rapidement l’omniprésence de dame métaphysique et corrélativement l’absence, sinon la présence inconsciente, de la seule méthode qui serait nécessaire : la dialectique[108] ?
Les héritiers de la pensée métaphysique en matière de représentation de la matière, et à ce titre relativement dépendants d'enjeux de classes, ont toujours eu du mal à concevoir une systématique qui ne s’arcboute pas sur de « hard and fast lines »[109] qui ne peuvent exister ni dans le monde du vivant ni à sa frontière.
Dans les années 1950 naît la systématique phylogénétique, autrement nommée le « cladisme »[110], mais sans que cette classification soit consensuelle puisqu'une autre école dite « évolutionniste » ou « synthétiste » s'y oppose[111], cette dernière prenant en compte également les différences de phénotype dans l'approche de la complexité du vivant. Les débats épistémologiques sur ces sujets sont encore vifs à l'heure actuelle et aucun consensus scientifique n'est obtenu[112].
Parmi les critères qui pourraient caractériser le vivant figure la possibilité de se mouvoir, se nourrir et se reproduire. L’argument fondamental pour ne pas classer le virus dans le monde du vivant est que le virus ne peut se reproduire sans la cellule[113]. Or dans le cas du lichen, rétorquerons-nous, qui est l'association indéfectible d'une algue et d'un champignon il n'y a pas d'autonomie possible pour chacun des deux éléments indépendamment de l'autre. Sur un autre plan, le virion est assimilé à une particule inerte et donc écarté du vivant, alors que les spores du champignon qui sont tout aussi inertes ne sont pas écartés de la sphère du vivant. Enfin, nous le verrons, et cela conduit nécessairement à un pas dialectique de plus, le vivant, assimilé ici à la cellule, ne peut évoluer et donc de reproduire que par l’action des virus qui contribuent à des transferts de gènes. De même que l’organique n’existe qu’en relation avec le minéral et inversement, le vivant cellulaire n’existe et n’évolue que parce qu’il est dans un bain de matière dite inerte, un bain de virus avec lequel il entretient une relation fusionnelle. Pour exister et se développer chacun a besoin de l’autre. Avec la particularité que les virus sont en bien plus grand nombre que les bactéries. Les cibles sont en bien plus petit nombre que les parasites et les parasites se reproduisent plus vite que les cibles qu’ils contribuent à faire évoluer. La matière « inerte » est dotée d’une « vitalité » plus grande que la matière « vivante » !
Un autre grand critère c'est « la capacité d'un organisme à trouver dans son environnement des éléments lui permettant de survivre » ; échanges de nutriments, production d'énergie, rejet des déchets des processus de transformation et de croissance. Or les virus ne possèdent pas en leur sein la machinerie biochimique nécessaire à ces processus et ils doivent utiliser celle des cellules.
Mais la découverte de virus géants comme les Mimivirus (1992)[114] puis les Mamavirus[115] (2008) et les Pandoravirus (2013) illustrent non seulement que certains virus dépassent la taille de certaines bactéries mais sont de plus, aussi ou même plus complexes que certaines d'entre-elles voire de cellules eucaryotes (cellules avec un noyau).
D’autre part, le détournement de la machine cellulaire par le virus conduit à un moment à un changement qualitatif, reconnu peut-être aussi par Lwoff[116], la cellule n’a plus de fonction reproductrice pour elle-même mais devient une unité productrice de virions. Ce qui fait dire à certains biologistes, mais c’est aussi un développement unilatéral, que nous sommes en présence de « cellules virales »[117].
Dans le même sens, leur patrimoine génétique n'a rien à envier à celui des bactéries à ADN. Alors que les virus courants, comme celui de la grippe ou du SIDA n’ont qu’une dizaine de gènes, le Mamavirus dépassait les mille gènes. Le Pandovirus élargit encore cette perspective. Le Pandovirus salinis dispose de 2500 gènes capables de fabriquer, selon le « code » génétique universel commun à l’ensemble du vivant, des protéines inexistantes dans le monde des autres virus et des organismes vivants. Le dogme d’une frontière nette entre le monde des virus et celui du vivant, dogme de base de la virologie établi dans les années 1950, reçoit un nouveau démenti. Ces virus conservent toutefois certaines caractéristiques propres aux virus : absence de ribosome, de production d'énergie et de division[118].
Par ailleurs ils sont, à l'instar des bactéries, eux aussi parasités par des virus plus petits ; les virophages[119]. Avec cette découverte est tombé l’argument qui laissait les virus en dehors du monde du vivant car ils ne pouvaient pas être infectés.
Un troisième critère retenu dans la classification du vivant est celui de la reproduction.
Dans ce domaine nous voyons que les virus qui certes, ne possèdent pas la faculté de se reproduire de façon autonome, ont tout de même un génome permettant à chacun de ses représentants de reproduire son espèce[120]. Bien plus, les analyses plus récentes[121] sur les Pandovirus (dont le nombre a augmenté) ont confirmé que ceux-ci avaient un très grand nombre de gènes dits « orphelins », c’est-à-dire sans équivalent dans les autres organismes (y compris les virus). Bien plus, la comparaison entre les divers Pandovirus montre que ces gènes orphelins sont particuliers à un Pandovirus donné. Ils ne résultent donc pas d’un ancêtre commun. D’où l’hypothèse d’une création spontanée et aléatoire de ces gènes à partir des régions « non-codantes » ou intergéniques du génome, fort importantes dans ce type de virus. Notons au passage que cette autre frontière entre l’ADN « codant » et « non-codant », dont nombre de biologistes pensaient qu’on pourrait s’en débarrasser, tend à se brouiller, le « non codant » devenant ici un réservoir potentiel de gènes nouveaux. La création de gènes de novo[122] a déjà été mise en évidence pour de nombreux organismes y compris pour la mouche du vinaigre. Par ailleurs, il a été montré que les gènes pouvaient voyager[123] entre des organismes qui ne relèvent pas de la même espèce contribuant ainsi à rapprocher des organismes qui, par ailleurs, sont engagés dans des processus de différenciation. En ce qui concerne notre sujet, les virus (ce peut être aussi le cas pour des bactéries) jouent un rôle dans ce transfert entre organismes et contribuent à modifier le génome des organismes vivants, ajoutant ainsi à la panoplie des modalités permettant de modifier le génome.
Outre le transport de matériel génétique en provenance de divers organismes, les virus parviennent également à modifier le génome dans la mesure où l’ADN viral peut aussi s’incorporer à celui-ci Si les plantes et les animaux contiennent des rétrovirus endogènes, il en va de même pour l’Homme moderne comme pour d’autres représentants du genre homo (néanderthaliens, denisoviens, …). « En conclusion, le génome comprend des séquences d'ADN d'origine rétrovirale (8%), vestiges de l'infection de cellules de nos ancêtres primates il y a plusieurs millions d'années et la plupart de ces séquences semblent inactives ; cependant certaines d’entre elles codent encore des protéines. Il existe une forte présomption pour qu’elles puissent jouer chez l’Homme un rôle en physiologie (placenta) ou en pathologie (maladies auto-immunes). Enfin ces séquences émanent des rétrovirus qui ont la capacité de transformer leur ARN en ADN (transcriptase reverse), ce qui les place dans une position favorable pour être à l’origine de la vie et de son évolution sur la terre. L’ARN et /ou le virus à ARN serait-il à l’origine de la vie ? La question est actuellement débattue par la communauté scientifique. On estime ainsi que 8%[124] du génome humain est d’origine virale. » [125].
Le génome humain étant constitué d’environ 3 milliards de paires de bases, cela représente environ 240 millions de paires de bases d’origine virale ! Les plus anciennes insertions rétrovirales dateraient de plusieurs millions d'années[126],Une nouvelle discipline a été créée pour étudier ces phénomènes : la Paléovirologie.
Enfin, la reproduction d'agents infectieux extrêmement mystérieux en tant qu'ils ont tendance à contrarier les principes de classification basés sur la possession d’acide nucléique (ARN ou ADN) ont remis en cause une autre frontière : celle qui n’admettait dans les agents infectieux que les virus, bactéries, champignons et parasites. La découverte des prions, classés désormais dans les ATNC, les agents transmissibles non conventionnels, responsables notamment de l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB -1986), la maladie de la vache folle, ou encore de l'Insomnie Fatale Familiale (IFF – 1986), montre qu'il existe des agents encore plus rudimentaires (ce sont des protéines dont la conformation est modifiée), a priori plus petits que les virus, ne possédant même pas de génome et pourtant capables de se répliquer.
Tous ces contre-exemples mettent à mal le système des représentations scientifiques attachées à définir « le vivant »[127]. Mais si le bourgeois métaphysicien en perd son latin, le dialecticien matérialiste y voit lui, au contraire, une preuve supplémentaire que les représentations de la matière, et de la matière vivante tout spécialement, ne sont que des étapes provisoires dans le vaste cours de la connaissance humaine.
Avec des virus (virus à ARN), sinon l’ARN lui-même, qui sont candidats à être à l’origine de la vie, qui sont des jalons (girius – virus gérants) vers les formes primitives de la vie et des foyers de création de gènes (pandovirus), qui interagissent avec le vivant (gènes voyageurs) et en deviennent des composantes permettant l’évolution du vivant (rétrovirus), les représentations qui reposeraient sur un « ou bien ceci ou bien cela », caractéristiques du mode de pensée métaphysique, doivent y ajouter le « aussi bien ceci … que cela », caractéristique de la pensée dialectique, afin d’assurer la médiation des contraires.
Notons au passage que les mécanismes purement darwiniens que le marxisme a toujours regardé avec circonspection[128] sont largement complétés sinon remis en cause.
4.2 Multiplication virale
Même s'ils ne peuvent le faire seuls, les virus possèdent néanmoins la capacité de se répliquer en tant qu'ils disposent d'un génome. Certes, cette réplication est soumise à leur absence d'autonomie, puisqu'elle exige d'eux qu'ils parasitent des cellules pour exploiter leur capacité reproductive et produire de nouveaux virions (les nouveaux individus, les nouvelles particules virales, propres au virus reproduits dans une cellule et possédant, s’ils n’ont pas muté, le même génome). C’est en infectant une cellule que les virus vont pouvoir disposer des systèmes de synthèse et de l’énergie qui leur est nécessaire pour leur réplication[129]. Les virus ne se divisent pas comme les cellules mais se répliquent. Pour se donner une idée, notons que la souche originelle du virus responsable de la Covid-19 peut se répliquer jusqu’à 100 fois en 48 heures. A ce titre il est de 5 à 10 fois plus rapide que celui du SRAS de 2003[130] Il produit également 3,2 fois plus de particules virales que le SRAS. En règle générale, la réplication des virus est à la fois très rapide et exponentielle[131].
Outre la réplication, les virus, et tout particulièrement les virus à ARN, les ribovirus, mutent rapidement. Les virus à ARN, comme les coronavirus sont des organismes dont l'évolution est très rapide[132].
Les rétrovirus sont des virus à ARN mais ils font l’objet d’un classement spécifique dans cette catégorie dans la mesure où ils passent par une rétrotranscription en ADN. Avec eux, un autre dogme de la biologie est tombé. Le schéma n’est plus univoque : ADN transcrit en ARN. Il admet sa réciproque, le phénomène inverse : ARN transcrit en ADN. Pour cette raison on parle de rétrotranscription et les virus sont appelés rétrovirus.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de souligner que ces organismes qui sont classés en dehors du monde du vivant sont aussi ceux qui ont la plus grande « vitalité ». Bien plus, ils sont un marqueur du vivant. Partout où il y a la vie, il y a des virus. En général, ils sont d’ailleurs en bien plus grand nombre que les organismes cellulaires. On estime qu’il y a dix fois plus de virus que d’organismes cellulaires.
Cette mutabilité à taux élevé sur laquelle repose leur potentiel évolutif, repose sur une multiplication d’« erreurs »[133] lors de la réplication du génome. Par exemple, dans le cas du VIH (le virus du SIDA), le taux d’erreur est de 1 pour 10 000 nucléotides (10-4) assemblés[134]. Comme le génome du VIH contient environ 10 000 nucléotides[135], généralement le fils est différent du père.
C’est que les virus à ARN sont incapables de « corriger ces erreurs » ce qui n’est pas le cas pour les virus à ADN qui bénéficient d’un « code de correction des erreurs ». « Le dernier nucléotide mis en place est systématiquement contrôlé. S'il existe une erreur d'appariement, il est retiré puis remplacé par celui qui convient. ». « La réplication de l'ADN est un processus très fidèle. Grâce aux mécanismes de correction, le taux d'erreur est faible. ». Les coronavirus ont un génome d’environ 30 000 nucléotides[136], ce qui est exceptionnel pour des virus à ARN, réputés les plus simples. Un telle taille devrait les prédisposer à des mutations mais il n’en va pas ainsi car, c’est une exception dans le monde des virus à ARN, ils disposent d’une enzyme (exonucléase) qui permet la correction d’erreurs[137].
De même qu’une secte qui a réussi devient une église, des mutations réussies se traduisent par une variation. Ces variations sont autant d’adaptations et de modalités par lesquelles les virus évoluent et par la même occasion maintiennent leur existence.
Outre les mutations, interviennent aussi des combinaisons. Une partie du génome d’un virus se combine avec le génome d’un autre pour former un nouveau génome. L’analyse du génome du SARS-CoV-2 a fait émettre l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de la combinaison de deux coronavirus infectant le même animal. Certaines séquences étant issues de la chauve-souris et d’autres du Pangolin. Si cette hypothèse est en définitive peu probable[138], il reste que les combinaisons de virus sont un phénomène d’autant plus fréquent dans le monde des coronavirus que les mutations y sont limitées par l’action d’enzymes correctrices. Les combinaisons entre virus de même nature sont assez fréquentes. En revanche, une combinaison entre deux virus différents suppose l’infection d’une même cellule par les deux virus ce qui rend ce phénomène extrêmement rare[139].
Si l’erreur au cours de la réplication est un des fondements de l’évolution des virus, l’erreur[140] avant la réplication n’en est pas moins un facteur important de l’évolution. Il ne s’agit pas alors tant du virus lui-même que de son hôte. Nous l’avons vu, le génome humain est composé pour environ 8% d’ADN d’origine virale. Mais comme les virus à ADN utilisent leur propre matériel génétique pour se répliquer, la présence d’ADN viral dans le génome ne provient que des rétrovirus. Ces séquences virales sont appelées rétrovirus endogènes (ERV). Les diverses modifications, mutations, recombinaisons, qu’ils ont subies les rendent généralement incapables de coder des protéines, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, des gènes de virus endogènes sont impliqués dans la formation du placenta. L’affaire remonte à loin, et des gènes ayant infecté des rongeurs il y a des millions d’années auraient un rôle dans la formation du placenta des mammifères actuels[141]. En règle générale, une fois l’ADN viral introduit dans la cellule hôte, les virus détournent à leur profit la machinerie cellulaire pour aboutir à la libération de nouveaux virions. Mais il arrive que ce détournement échoue. S’il concerne une cellule germinale, l’ADN proviral reste dans le patrimoine génétique et peut se transmettre de génération en génération[142]. Ces échanges entre virus et hôtes ont contribué à l’évolution de la vie sur la planète. Ce phénomène nommé transfert horizontal de gènes permet des transmissions de matériel génétique entre divers organismes, et se distingue donc de la transmission "verticale" de l’ADN qui va des parents à la progéniture. Ces transferts ont des conséquences évolutives pour le virus et l’hôte, jouant un rôle important dans la diversité de la vie tout en étant un facteur d’évolution du vivant lui-même[143].
4.3 Les virus ne sont pas forcément dangereux
Face à la dramatisation excessive que la bourgeoisie a développée face à la pandémie de la Covid-19, il convient de souligner à quel point les virus ne sont pas nécessairement dangereux pour l'humanité.
Nous avons déjà rappelé que l’étymologie de virus (toxine, poison) n’était plus en phase avec la représentation que s’en fait aujourd’hui la biologie. S’ils ont été tout d’abord appréhendés à travers leur dimension pathogène, et pendant toute une période les virus ont été classés en fonction des maladies qu’ils provoquaient, une meilleure compréhension de leur rôle conduit à ne plus voir en eux des ennemis systématiques qu’il faudrait éradiquer.
Nous avons déjà montré qu’ils étaient un facteur indispensable à la vie et à son évolution, que l’échange et les relations entre les organismes « inertes » qu’ils sont quand ils prennent la forme du virion et la cellule dotée d’autonomie, avec son métabolisme, étaient indispensables l’un à l’autre pour évoluer et créer les conditions et des formes de vie supérieures. En effet, outre la complexification de la vie par l’évolution et l’agrégation des micro-organismes, les bactéries, associées aux virus, ont permis que s’établisse l’atmosphère terrestre que nous connaissons avec notamment le remplacement d’une grande partie du dioxyde de carbone par de l’oxygène. De même une partie des gènes responsables de la photosynthèse de certaines bactéries sont d’origine virale.
D’une certaine manière on peut dire que l’Homme baigne dans un bain de micro-organismes, bactéries, champignons, virus. Le nombre de bactéries sur le corps humain est supérieur au nombre de cellules humaines et on estime à 3000 milliards (environ 1/10 des cellules) le nombre de virus sur le corps humain qui en inhale 200 000 par minute. Ils sont indispensables à la vie de l’Homme et contribuent aussi bien à son équilibre vital qu’à sa déstabilisation[144]. Par exemple, si nous prenons le microbiote de la peau, diffèrent par ailleurs suivant les zones de celle-ci, il est composé de bactéries, de champignons et de virus qui agissent de concert avec les cellules de la peau pour la protéger contre d'autres micro-organismes pathogènes[145].
Nous arrivons à une époque ou virus et bactéries qui sont une part fondamentale de notre écosystème sont susceptibles d'être utilisés consciemment par l’Homme. Nous sommes passés du stade de leur invisibilité et de leur domination exclusive aux premières heures de la vie, à la reconnaissance de leur existence, tout d’abord via les effets pathogènes qu’ils pouvaient avoir sur l’Homme, les plantes et les animaux pour arriver à un stade ou le degré de connaissance scientifique permet de les utiliser et de les dominer. Cela ne va pas dans notre mode de production sans apprentis sorciers puisque, par exemple, une hypothèse qui a toujours de l’actualité veut que le virus de la covid19 se soit échappé d’un laboratoire. Et comme les guerres et leurs préparatifs sont un facteur accélérateur de la recherche scientifique et technique, nous savons que la guerre bactériologique vient compléter les guerres nucléaire, chimique ou mécanique. Signe d’un hyper développement du mode de production capitaliste, la science qui correspond à cette époque est la biologie, une science où les lois du mouvement y sont les plus complexes et qui exige d’autant plus de penser dialectiquement[146].
Le concept de bactériophage a été créé par Felix d'Hérelle (1873-1949). Autodidacte en bactériologie, selon ses dires, il isole l'agent infectieux de l'entérite des sauterelles ce qui lui permettra de lutter efficacement contre les invasions de cet insecte. Par la suite il découvre l'existence de virus[147] antagoniques du bacille dysentérique.
Cette recherche sera supplantée par la découverte des antibiotiques mais cette thérapie, qu’il nommera phagothérapie essaimera dans le monde. En particulier en Géorgie et via celle-ci dans d’autres parties de l’Union soviétique par l’intermédiaire d’un des élèves d’Hérelle, George Eliava faisant de la Géorgie et de la Russie un des centres actifs encore actuel de production de bactériophages. Devant le développement de la résistance aux antibiotiques la phagothérapie reçoit un regain d’intérêt. Par exemple, la société Pherecydes Pharma, introduite récemment en bourse (elle a aujourd’hui perdu 80% de sa valeur d’introduction), se propose de développer cette thérapie[148].
Un autre aspect des virus qui nous permettrait de tirer avantage de leur configuration, serait de les transformer en distributeurs de produits thérapeutiques. Ils présentent en effet l'avantage de cibler des cellules particulières et si on les vide de leur génome tout en conservant leur capside, on leur ôte tout potentiel pathogène et on les transforme en « nano-boîtes » de médicaments en quelque sorte, qui iront délivrer le traitement dans la cellule visée, il s'agit des virosomes[149].
Il y a tout de même à l'heure actuelle un obstacle majeur à la généralisation du procédé c'est que le système immunitaire ne distingue pas le « virus-boîte de médicaments » du virus sauvage... « C'est pas gagné ! » comme dirait l'autre, mais c'est prometteur.
L'évolution du règne animal à laquelle nous appartenons en tant qu'espèce a pu se poursuivre jusqu'à aujourd'hui à travers ce subtil jeu de conquête et d'intégration, d'esquive et de côtoiement, de coopération ou de lutte à mort, entre différentes espèces naturelles en lice et ce n'est pas le statut d'espèce dominante de la nature qui peut définitivement nous émanciper de cette lutte permanente à assurer notre existence et notre développement dans l'univers jusqu’à notre propre dépassement.
5. Mathématisation des études sur la diffusion des maladies contagieuses
« Pouvons-nous dans nos représentations et nos concepts du monde réel donner un reflet fidèle de la réalité ? » (Engels, Ludwig Feuerbach…, ES p. 28)
Avec l’extraordinaire progression de la pandémie due au virus SARS-CoV-2, on a vu surgir de partout une pléthore de charlatans propageant des cures miraculeuses à côté de chercheurs sérieux (épidémiologistes, virologistes…) qui s’efforçaient de comprendre le phénomène. On a vu des gouvernements avides de mettre en œuvre des mesures de contrôle social sous couvert d’une politique de protection sociale à côté de professionnels de santé épuisés par de longues journées de soins. On a vu des géants pharmaceutiques développer en un temps record des vaccins contre la COVID-19 au milieu d’une féroce guerre pour accaparer la plus grande part de cet immense marché et les profits et surprofits qui vont avec, tandis qu’à la submersion des systèmes hospitaliers publics répondait la marée montante de leurs coûts, que par ailleurs, la bourgeoisie s’était efforcée de réduire depuis des décennies. Enfin, on a vu une combinaison disparate de réactions en face de la puissance de cet évènement sanitaire qui a mis à nu l’incapacité et l’incurie des bourgeoisies nationales à maîtriser la situation. Les populations étourdies ont reçu via les médias les plus autorisés une avalanche de prévisions contradictoires basées sur des courbes d’infections, de décès, d’hospitalisations, etc. Ces annonces étaient précédés – d’une façon explicite ou implicite - par une justification de ce qu’elles étaient fondés sur des « bases scientifiques », malgré la multitude frappante des échecs de leurs prévisions.
Ces résultats contradictoires ont renforcé les discours anti-scientifiques tout particulièrement répandus avec une extraordinaire amplification par lesdits « réseaux sociaux », qui niaient, parmi d’autres aspects, l’utilité des modèles épidémiologiques comme outil d’appui à la compréhension des phénomènes épidémiques et à la formulation des hypothèses prédictives sur leurs évolutions[150]. De toute façon, on peut se demander si les critères scientifiques qui fondent ces modèles sont suffisants pour nous donner la capacité de comprendre l’évolution des épidémies. Permettent-ils de l’anticiper et de mieux guider la vie sociale selon les particularités des territoires frappés par des virus dangereux ? Quel est le degré de fidélité et d’utilité des représentations et des concepts exprimés par ces modèles soutenus sur un appareil mathématique important ?
5.1 Difficultés pour la prédiction de la propagation des maladies infectieuses
Depuis le déclenchement de l’épidémie de COVID-19 au Wuhan, nombre de prestigieuses institutions bourgeoises, partout dans le monde, ont annoncé leurs projections pour l’épidémie en Chine. Pourtant, leurs résultats présentaient une très large variation : par exemple, l’estimation du nombre de reproduction de base (nombre que le grand public allait apprivoiser sous le terme de R0), c’est-à-dire le nombre moyen de personnes qu’une personne infectée peut contaminer (juste au début d’une épidémie avant que des mesures de contrôle sanitaire soient mises en œuvre), variait entre 2 et 6, et le nombre de personnes infectées de 50.000 à plusieurs millions, etc. Pourquoi une telle variation, alors que des modèles mathématiques consacrés par l’expérience épidémiologique sont utilisés depuis longtemps ?
Concernant les résultats des modèles fondés sur les données disponibles avant le 23 janvier 2020 – où Wuhan a fait l’objet d’un confinement général -, une réponse simple est qu’il y a eu très peu d’information avant cette date. Cependant, d’une manière générale, pour une épidémie qui s’avère très contagieuse et possède un taux de létalité[151] important, ne faut-t-il pas disposer de modèles dont les résultats soient plus précis afin que des mesures sanitaires efficaces puissent être mises en place rapidement pour contrôler sa propagation, même si les informations sont éparses ? On peut entrevoir ici deux problèmes : la définition d’un modèle de représentation de la réalité dynamique de la transmission d’une épidémie et la maîtrise effective de la situation sanitaire qui en découle.
Quel que soit le modèle choisi, le manque de données utiles est une préoccupation permanente pour la modélisation scientifique. La production comme la diffusion de ces données sont en relation avec le mode de production en vigueur et donc, à notre époque, tributaires de la société bourgeoise contemporaine et de ses effets délétères. D’autre part, on peut également se demander si le modèle reflète bien au cours du temps le comportement changeant des phénomènes exprimés par les données disponibles et, tout particulièrement, s’il aide à améliorer leur compréhension.
Une des explications pour la variabilité des modèles épidémiologiques est le degré de connaissance des relations entre les données disponibles (par exemple, les chiffres de cas confirmés) et les résultats du modèle. Normalement, la notion de cas confirmé s’applique aux personnes avec des symptômes de la maladie qui ont contacté un service de santé, effectué un test de détection et confirmé l’infection par des tests supplémentaires. Cependant, les paramètres des modèles types de transmission d’une infection supposent que le nombre d’infectés est équivalent à toute la population infectée. Dans la réalité, les cas confirmés ne sont qu’une fraction du total de la population infectée. Celle-ci est d’autant plus méconnue par les organismes de santé que les programmes gouvernementaux de tests sont largement insuffisants. Cette fraction, généralement largement majoritaire et qui appelle la métaphore de l’iceberg, constituée par les symptomatiques non testés, les asymptomatiques, les erreurs de diagnostic (qui jouent dans les deux sens) est fréquemment appelée : « épidémie cachée »[152]. L’expérience épidémiologique montre que le rapport entre les cas confirmés et le total de la population infectée peut varier largement selon la nature des infections virales[153] et, tout particulièrement, pour une épidémie émergeante encore inconnue. La grande amplitude de la variation potentielle de ce rapport a de grandes conséquences sur l’évaluation du taux de transmission de la maladie et des facteurs qui sont à la base des modèles épidémiologiques.
En dépit des progrès dans l’épidémiologie et la virologie, tant du point de vue théorique que technique, le non-spécialiste ne peut que constater qu’il reste pas mal de difficultés pour évaluer la relation entre « épidémie cachée » et « épidémie attestée ». Les mutations continuelles, plus ou moins importantes des virus, favorisées par l’incapacité des bourgeoisies nationales à maitriser la crise sanitaire et la complexité du mécanisme de transmission de la maladie en font une des premières raisons.
Il y a une grande complexité dans la combinaison de nombre de facteurs que nous diviserons en deux catégories pour faciliter leur identification.
La première comprend les interactions entre les pathogènes, entre ceux-ci et les humains, et entre les humains eux-mêmes.
La deuxième subsume la première au sein des interactions démographiques, environnementales, sociales et politiques.
Néanmoins, il ne faut pas écarter – ce que les modèles existants font - que toute cette dynamique se produit sous la domination des rapports sociaux capitalistes, qui amplifient la concurrence entre institutions de recherche qui est un aspect de la concurrence entre bourgeoisies nationales à la recherche de gloire et de célébrités, l’incurie de ces mêmes bourgeoisies et de leurs Etats pour maîtriser la situation sanitaire, autant de facteurs qui aboutissent à saboter les efforts pour la compréhension du problème. Qui plus est, le terme lui-même : « épidémie cachée » porte bien son nom ; il est en soi très révélateur. Les Etats bourgeois (nous avons vu ci-dessus que les classes dirigeantes se comportent de la même manière lors des épidémies) cachent sans exception le déclanchement d’une épidémie et la portée de sa transmission, qui peut menacer d’une façon plus au moins importante la tranquillité des affaires et donc la production d’un maximum de plus-value.
D’un point de vue pratique, la mise en avant des facteurs politiques et sociaux dominants ne doit pas faire oublier les difficultés d’ordre opérationnel (qui certes ne sont pas indépendantes des rapports sociaux) que toute organisation doit prendre en compte pour évaluer l’importance de l’« épidémie cachée » (logistique d’un large programme de dépistage, personnel qualifié disponible, importance des symptômes qui conduisent à entrer en contact avec un organisme de santé, part des asymptomatiques, …) et qui demandent une masse importante de travail social.
Quant aux populations, une question sensible est que si on ne dispose que du nombre de cas confirmés, le taux de létalité de la maladie infectieuse est d’autant plus grand que la part de l’« épidémie cachée » est importante. Donc, selon les circonstances politiques et sociales, le maintien de la méconnaissance de la partie cachée, quand ce n’est pas l’épidémie elle-même, peut être politiquement manipulée de façon convenable par les classes dirigeantes. Par exemple, aussi longtemps que le nombre absolu des décès ne paraît pas important, un gouvernement peut limiter les investissements en politiques efficaces de dépistage et d’infrastructure de santé publique. De même, un gouvernement peut écarter la mise en œuvre de stratégies privilégiant la prévention (par exemple, le confinement) qui pourraient menacer les affaires, au nom du « maintien des emplois » et de la « santé de l’économie ». Par contre, en faisant d’un taux de décès élevé un spectacle terrifiant, la peur propagée peut favoriser l’obtention d’un soutien favorable à un gouvernement pour mettre en œuvre des mesures d’exception qui apparaissent comme des mesures de protection de santé publique, mais qui interdisent par la même occasion certaines expressions de la lutte des classes (réunions, manifestations, ...)
5.2 Petit historique de la modélisation mathématique en épidémiologie
« Marx retrouvait dans les mathématiques supérieures le mouvement dialectique sous sa forme la plus logique et la plus simple. Une science, disait-il, n'est vraiment développée que quand elle peut utiliser les mathématiques. » (Lafargue, P. Souvenirs personnels sur Karl Marx, Die Neue Zeit, IX Jhrg., 1890-1891, pp. 10-17, 37-42.)
L’utilisation de modèles mathématiques en tant que support de premier ordre dans les recherches sur la nature des phénomènes épidémiologiques a une longue histoire : presque 400 ans !
L’étude systématique des données des maladies et des décès qui en découlent commencerait avec John Graunt (1620-1674)[154], un mathématicien et démographe anglais contemporain de l’essor de la manufacture (et pour cause !) et de l’augmentation qui lui est liée de la population de Londres (de 50.000 à 500.000 habitants environ entre 1500 et 1700)[155]. Il analysait les bulletins de décès hebdomadaires de la grande ville pour estimer de façon systématique les risques comparatifs de mourir de maladies diverses. Il propose la première approche connue en épidémiologie comme la théorie des « risques concurrents »[156].
Le mathématicien suisse Daniel Bernoulli (1700-1782) a conçu une approche plus théorique des effets d’une maladie infectieuse, en l’occurrence la variole. Il proposait, apparemment pour la première fois, un modèle mathématique en épidémiologie lors de ses études des risques de la variolisation (l’inoculation avec un virus vivant obtenu directement d’un patient avec un cas léger de variole ; cette méthode est l’ancêtre de la vaccination). A l’époque, la variole est endémique et responsable de la mort d’environ 10% des enfants. Son modèle dérivait de l’analyse des décès et son but était de calculer l’augmentation de l’espérance de vie si la variole pouvait être éliminée comme cause des décès. Les résultats des calculs du modèle sur les cas de mortalité dues à la variole montraient l’avantage de la variolisation[157], c’est-à-dire la diminution du risque de mourir de la variole comparativement aux autres causes de mortalité par des maladies concurrentes.
Plusieurs études ont suivi afin de comprendre les causes et les mesures de prévention des maladies infectieuses, tout particulièrement par la connaissance, depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe, du mécanisme de leur transmission du fait du contact entre un individu infecté et un individu sain.[158]
Dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre, Engels décrit largement l’énorme mortalité (spécialement l’effroyable mortalité infantile) et les épidémies périodiques (variole, rougeole, choléra, typhus…) qui frappaient le prolétariat anglais. La grande industrie est en plein essor dans les années 1830-1840 et les statistiques montrent que ces maladies étaient, en général, plus meurtrières dans les grandes villes que dans les régions rurales. Dans ce contexte social, en 1840 William Farr (1807-1883), un épidémiologiste anglais, compilant les données, entre 1837 et 1839, du rapport annuel de naissance et mortalité en Angleterre et le Pays de Galles sur les maladies comme causes des décès, essaie de caractériser mathématiquement le taux de décès trimestriel dû à l’épidémie de variole. Farr concluait que dès lors que l’épidémie régresse, on peut détecter un taux constant de décélération dans le nombre de décès par trimestre, lequel arrive à une intensité minimale et reste stationnaire. Quoiqu’il ne procède à aucune formalisation mathématique pour la courbe résultante du cours observé de l’épidémie, il note que les évènements épidémiques augmentent et diminuent dans une tendance approximativement symétrique qui peut s’approcher d’une « courbe en cloche » de Gauss[159]. Cette conclusion, qu’il a observée pour d’autres épidémies (peste bovine en 1866, par exemple) est connue comme « Loi de Farr » et a joué un rôle important dans l’histoire de l’épidémiologie.
Malgré les analyses empiriques, on n’avait pas, à l’époque, de modèle théorique pour expliquer la dynamique de diffusion d’une maladie. Pour avoir une représentation mathématique d’un modèle de propagation d’une maladie infectieuse qui permettrait son calcul, il fallait avoir, au-delà des connaissances du phénomène pathogénique, quelques suppositions sur la dynamique de diffusion de l’infection dont le support fondamental est une forme de contact. Apparemment, la première description d’un modèle mathématique de transmission de maladies infectieuses est due, en 1889, au médecin russe Pyotr Dimitrievich Enko (1844-1916)[160]. Mais, ce n’est qu’en 1906, avec le médecin anglais William Heaton Hamer (1862-1936), dans ses études sur la récurrence d’épidémies de rougeole et de grippe à Londres, qu’on élabore un modèle mathématique plus cohérent. Les ajustements de données préfiguraient l’application d’un principe connu désormais comme « la loi d’action de masse » laquelle comprend le principe du « mélange homogène ». Le premier concept, importé de la chimie[161], implique que, dans la transmission d’une infection, le nombre de cas secondaires engendrés par un individu infectieux est proportionnel au nombre d’individus sains dans la population à un moment donné ; le nombre de reproduction de base (R0) qui devient (Rt), le nombre de reproduction effectif, dès lors que l’on prend en compte le temps est donc variable et décroissant. Le deuxième concept considère que les interactions entre individus suffisamment nombreux induit une contamination homogène, égale à ce nombre de reproduction au temps t, pour un très bref intervalle de temps. Ces résultats théoriques sont à la base de nombre de développements ultérieurs de la théorie de la transmission des épidémies.
Le médecin anglais Ronald Ross (1857-1932)[162], qui a reçu le Nobel de Médecine en 1902[163] pour son travail sur la malaria, poussait plus avant la modélisation de la dynamique de transmission des épidémies en proposant, en 1911, un modèle mathématique de prédiction de la transmission de la malaria par les moustiques (les vecteurs de l’infection), à base d’équation différentielle afin de représenter plus fidèlement son évolution dans le temps. Le modèle montrait que la réduction de la population de moustiques en dessous d’un seuil critique estimé serait suffisante pour endiguer la propagation de l’épidémie, sachant qu’il était impossible d’éliminer toute la population de moustiques.
Les travaux du biochimiste écossais William Ogilvy Kermack (1898-1970) et du médecin et épidémiologiste, également écossais, Anderson Gray McKendrick (1876-1943) permettaient de faire un pas en avant par rapport aux modèles de leurs prédécesseurs et dans l’histoire de la modélisation mathématique en épidémiologie. Ils proposèrent en 1927 un formalisme plus cohérent pour caractériser les éléments de base d’un modèle général de transmission des épidémies qui mûrissait depuis Bernoulli[164]. Dans son essence, le modèle de Kermack-McKendrick peut être décrit comme un modèle compartimental avec trois compartiments[165] qui caractérisent les individus d’une population du point de vue d’une épidémie : le compartiment S (pour susceptibles en anglais) contient les individus sains qui n’ont pas l’immunité et donc qui sont susceptibles d’être contaminés ; le compartiment I (pour infected en anglais) contient ceux qui ont la maladie – les infectés - et peuvent la transmettre ; le compartiment R (pour removed en anglais) contient ceux qui ne sont plus malades - les retirés -, soit parce qu’il sont morts, soit parce qu’il sont guéris et par suite immunisés (recovered en anglais, guéries) après l’infection. Ce modèle, connu plus tard comme SIR et popularisé actuellement par les médias pendant la pandémie du Covid-19, est le plus simple et le plus fondamental des modèles théoriques en épidémiologie.
Les deux propriétés fondamentales du modèle sont :
(a) il y a une quantité limite qui détermine si la maladie s’éteindra sans se répandre ;
(b) l’épidémie s’éteindra en laissant quelques individus non infectés.
Il permet de calculer la variation de la proportion de la population dans chacun des compartiments à chaque moment du temps et la détermination du taux de variation du flux d’individus par unité de temps entre les compartiments, c’est-à-dire des individus sains susceptibles d’être infectés qui le deviennent (taux d’infection) et de ceux qui étaient infectés et qui sont guéris (taux de rétablissement). Basé sur les caractéristiques épidémiologiques de la maladie, il suppose que le taux per capita qu’un individu sain soit infecté est proportionnel à la prévalence de l’infection au sein de la population[166] ; ce taux n’est pas constant au cours du temps.
Néanmoins, ce modèle considère que la population est constante, c’est-à-dire qu’il ne prend pas en compte les naissances et les décès autres que ceux dus à la maladie, et qu’elle possède la propriété de « mélange homogène » que nous avons vue ci-dessus. Pour traiter les caractères endémiques d’une épidémie (son établissement et sa persistance au sein d’une population), nos auteurs ont publié en 1932 et 1933 des extensions du modèle de base. En bref, le modèle originel (1927) donne une formulation mathématique plus cohérente aux conclusions empiriques de Farr. Le nombre d’infectés augmente de façon exponentielle jusqu’à ce que la proportion de gens sains (compartiment S) dans la population ait suffisamment diminué et que la proportion des gens guéris immunisés (compartiment R) ait suffisamment augmenté[167]. A partir de là, le nombre de personnes infectées commence à diminuer jusqu’à une possible extinction de l’épidémie, parce qu’une partie toujours croissante de la population guérit tandis que l’épidémie rencontre chaque fois plus de difficultés pour se diffuser[168]. La solution quantitative d’un tel modèle, pour le nombre d’individus infectés par unité de temps, peut être représentée par une « courbe en cloche », une courbe de Gauss (quand-même !), bien qu’elle ne soit pas approximativement symétrique comme le pensait Farr, mais asymétrique : la queue de la courbe est plus longue après le pic. La Figure 1 montre un exemple hypothétique de ce phénomène[169].
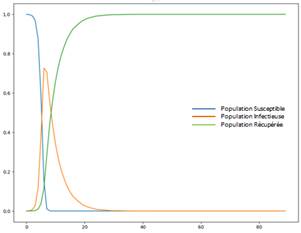
Figure 1 – Exemple de solution d’un modèle SIR
Le modèle de Ross, comme le modèle de Kermack-McKendrick, contient une quantité limite au-dessus de laquelle l’épidémie se propage au-delà d’un équilibre endémique. Il semble que l’anglais George MacDonald (1903-1967), dans ses travaux sur la malaria[170], soit le premier à nommer cette quantité limite de « nombre de reproduction de base », le fameux R0 des modèles modernes : le nombre moyen d’infections produites par un individu infecté au sein d’une population supposée entièrement saine[171]. Pour simplifier ce sujet compliqué, les modèles Kermack-McKendrick et de Ross sont dits modèles déterministes, parce qu’ils supposent que la taille des populations de chaque compartiment n’est qu’une fonction déterministe du temps. En d’autres termes, ce genre de modèle veut prédire d’une manière déterministe leurs quantités à un quelconque moment du temps à partir des conditions initiales de la période modélisée. La possibilité de cette prédiction dépend donc de la connaissance de ces conditions initiales, c’est-à-dire de l’état de la « triade épidémiologique » - agent infectieux, hôte de l’infection, facteurs environnementaux -, connaissance limitée par les possibilités pratiques de leur obtention.
Une hypothèse importante de ce type de modèle consiste à considérer que la taille des populations des compartiments est suffisamment importante pour qu’on puisse homogénéiser le comportement des individus qui les composent (« mélange homogène »). Dans ce cas, les effets des actions aléatoires particulières de certains individus (super contaminateurs, individus infectés contaminant un grand nombre de personnes, par exemple. Dans le cas de la covid, on estime que 10% des personnes contaminées sont responsables de 80% des contaminations) sont intégrés dans la tendance globale de la dynamique de transmission de la maladie. Cependant, au moment même du déclenchement d’une maladie infectieuse, le nombre d’individus infectés est relativement petit. Dans ce cas, les effets de leurs contacts aléatoires gagnent de l’importance et doivent être pris en compte. Ceci vaut aussi pour une population petite en taille. La modélisation d’un tel processus est plus compliquée et le type de modèle normalement employé est un modèle dit stochastique[172]. Les observations épidémiologiques constatent que dès lors qu’il existe un haut niveau d’incidence d’une maladie infectieuse au sein d’une population importante, un modèle déterministe peut être considéré comme une approximation raisonnable de la tendance de l’évolution de la diffusion de la maladie[173], malgré la nature aléatoire de la diffusion.
Le modèle d’Enko, mentionné ci-dessus, est le précurseur du modèle stochastique Reed-Frost, en référence au biostatisticien Lowell Reed (1886-1966) et à l’épidémiologiste Wade Hampton Frost (1880-1938). Il a été présenté par Frost en 1928. Une de ses suppositions est que chaque individu infecté pendant une période infecte de façon indépendante chaque individu sain avec une certaine probabilité. Pour une vaste population, cette probabilité peut être assimilée au « nombre de reproduction de base » (R0). Le modèle est donc calculé à maintes reprises et à chaque période il ajuste les conditions initiales selon les données empiriques de l’évolution d’une épidémie pour estimer son évolution pour les périodes successives. En 1949, le statisticien anglais Maurice Stevenson Bartlett (1910-2002) poussait cette approche plus loin et formulait un processus stochastique évolutionnaire où les probabilités de transmission d’une infection varient dans le temps selon la variation des flux d’infectés et de gens sains (il considérait l’immigration ou la reproduction démographique, par exemple) au cours d’une épidémie[174]. En partant du travail de Bartlett, le statisticien suisse Norman Thomas John Bailey (1923-2007) proposait en 1950 un modèle stochastique, qu’il qualifiait de « simple », pour améliorer le modèle Kermack-McKendrick lorsque les populations sont plus petites. Il faut souligner que le modèle stochastique de transmission d’épidémies de Bailey et une grande partie des modèles stochastiques qui le suivent, se rapportent directement aux modèles à compartiments, comme le SIR.
5.3 Avons-nous besoin d’une multitude de modèles ?
« Mais comme dans tous les domaines de la pensée, à un certain degré de développement, les lois tirées par abstraction du monde réel sont séparées du monde réel, elles lui sont opposées comme quelque chose d’autonome, comme des lois venant de l’extérieur, auxquelles le monde doit se conformer. C’est ainsi que les choses se sont passées dans la société et l’État ; c’est ainsi et non autrement que la mathématique pure est, après coup, appliquée au monde, bien qu’elle en soit précisément tirée et ne représente qu’une partie des formes qui le composent - ce qui est la seule raison pour laquelle elle est applicable. » (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p. 69)
De ce petit historique, nous pouvons conclure que les modèles mathématiques de transmission des épidémies s’efforcent d’énoncer sous une forme plus claire les hypothèses sur les caractéristiques épidémiologiques qui influencent la diffusion d’une maladie infectieuse. En recourant aux structures mathématiques, l’un de leur but est donc d’aider les épidémiologistes à préciser leurs observations, leurs connaissances conceptuelles et intuitives sur les processus de transmission, d’infection, de guérison des individus[175]. Un autre objectif est d’essayer de projeter les contours d’un cours épidémique (par exemple l’estimation du nombre total d’individus qui pourraient être affectés par une épidémie) afin d’estimer, notamment, l’importance du travail social à engager dans la santé publique pour faire face à cette épidémie. Il peut s’agir aussi d’évaluer les effets de mesures sanitaires comme la vaccination (en réduisant le nombre de personnes saines susceptibles d’être infectées à un niveau inférieur à une quantité donnée), l’utilisation des masques, l’isolement, le confinement, etc.
Les modèles sont donc des outils pour aider la formulation et au test des théories épidémiologiques. Mais, pour accomplir cette tâche ils requièrent la disponibilité et la qualité des données sur la réalité épidémique. Normalement, les données disponibles provenant soit de la soudaine apparition d’une épidémie soit d’une situation endémique ne sont pas complètes et fiables, parce qu’un grand nombre de cas ne sont pas connus. Typiquement, pour les maladies qui adviennent périodiquement (grippe, par exemple), même si le pathogène a subi une mutation, l’analyse commence par la prise en compte des données de la période précédente. Quoi qu’il en soit, il faut réaliser continuellement la calibration du modèle, c’est-à-dire que ses résultats doivent être ré-estimés (variation inattendue du nombre de nouveaux cas d’infection quotidiens, par exemple) avec les données réelles[176]. En utilisant des méthodes statistiques appropriées, il faut évaluer la cohérence des écarts entre les données collectées à un moment de l’épidémie et leurs valeurs attendues par le modèle en question. Si le résultat est en dehors des marges d’erreur, ceci peut indiquer que les paramètres du modèle de départ ne sont pas valables et doivent être adaptés ou que le modèle lui-même n’est pas plus valable et doit être écarté.
Pour élaborer un modèle d’un phénomène, il faut décider de son degré d’abstraction : quelles caractéristiques doivent être incluses et lesquelles doivent être omises ? Mais pour n’importe quel modèle, ce choix dépend des questions auxquelles il doit répondre et de la qualité des données disponibles sur lesquelles il doit se fonder. Ce qui veut dire que pour un même territoire frappé par une épidémie, des modèles basés sur des questions différentes donnent des résultats distincts[177]. Ce choix pose un problème de compromis entre la complexité d’un modèle théoriquement plus approprié à la situation sanitaire effective et la possibilité d’obtenir des données fiables correspondant à la réalité modélisée, sachant qu’il s’agit de répondre aux questions posées par les épidémiologistes et non par les mathématiciens. Il faut donc prendre en compte les limitations des modèles pour répondre à certaines questions épidémiologiques ; ce n’est que dans ce sens que l’épidémiologie peut utiliser des modèles mathématiques dans son évolution en tant que branche de la connaissance scientifique.
On peut noter que, d’une manière générale, les mathématiciens tendent à élaborer des modèles moins complexes pour favoriser une connaissance plus globale du phénomène étudié ; le formalisme cherche à donner une solution qui prouve ou réfute les hypothèses de départ. En revanche, la gestion de la santé publique exige une bonne dose de détails pour décrire plus précisément les caractéristiques de la maladie et les conditions de sa transmission et pour mettre en œuvre des mesures pratiques pour la maîtriser[178]. Cependant, nous pouvons observer dans la présente pandémie de Covid-19 que pas mal de modèles tendent à un mélange nuisible de ces aspects pour répondre aux questions diverses selon l’intérêt de différents ordres : politique des bourgeoisies nationales, concurrence des entreprises pharmaceutiques, concurrence entre scientifiques, etc.
Comme on peut le déduire de la citation d’Engels ci-dessus, les lois tirées par abstraction du monde réel et gagnant une vie propre ne doivent pas s’opposer à la réalité comme une chose autonome ; elles ne sont applicables au monde que si elles représentent des parties que le composent. Dans la perspective épidémiologique ceci pourrait signifier, par exemple, qu’il est acceptable de commencer la modélisation par les caractéristiques générales de la population saine, infectée et retirée sur un territoire si on ne dispose pas au départ de données détaillées sur la « triade épidémiologique » (agent infectieux, hôte de l’infection, facteurs environnementaux); cependant, cela ne veut pas dire qu’il est acceptable de se fier aux seules conséquences logiques engendrées par un modèle mathématique qui n’ont de validité que dans le cadre étriqué de leur représentation formelle, en substituant une « réalité » mathématique à la réalité de facto.
Une bonne partie des maladies provoque des effets différents suivant la tranche d’âge des personnes susceptibles d’être contaminées. Historiquement, la structuration de la population par âge a été la première modification importante introduite dans les modèles[179]. Une autre caractéristique importante des populations est que certains groupes ont un risque d’être infecté bien plus grand que d’autres en dépit de l’âge. Sur ce point, les modèles sont confrontés à l’anarchie des rapports de production capitalistes qui entassent la population dans des grandes villes. Ce fait met en évidence une des effets néfastes de la séparation entre ville et campagne que le mode de production capitaliste pousse à son comble[180].
Ces facteurs et leur combinaison induisent la diversité de modèles qui peuvent être plus ou moins fidèles à la réalité épidémiologique analysée. En d’autres termes, la diversité des caractéristiques de la « triade épidémiologique » demande une diversité de modèles pour une représentation plus appropriée de la réalité épidémiologique. Par exemple, il y a des maladies où les infectés retournent à la classe des sains après la disparition de l’infection (rhume causé par rhinovirus, par exemple), au lieu d’être considérés comme appartenant à la classe des retirés, parce que la maladie ne confère pas d’immunité contre la réinfection. Dans ce cas, au lieu d’un modèle du type SIR, on a un modèle du type SIS (sains-infectés-sains), où les infectés reviennent à l’état sain après l’infection.
Il y a d’autres réalités du même ordre. Il existe des maladies (herpès, par exemple) où l’individu, une fois infecté et sans aucun traitement, reste infecté, ce qui peut être représenté dans un modèle de type SI (sains-infectés). Pour d’autres maladies, où l’immunité n’est que temporaire (influenza-grippe, par exemple), on peut avoir un modèle du type SIRS (les retirés retournent à la classe des sains au bout d’un certain temps). Il existe aussi des modes de transmission des maladies plus compliqués, avec une période significative entre le moment de l’infection et celui où on est infectieux. Dans cette période d’incubation, les individus sont dits exposés (E) : d’où les modèles SEIR et SEIS (inclusion des exposés aux modèles SIR et SIS)[181]. D’un autre côté, il existe des variantes pour analyser une question importante, comme par exemple, la dynamique des décès (D) due à une maladie avec un taux de létalité élevé (Ebola, par exemple) : modèle SIRD. De même, une variante peut justifier d’isoler une catégorie qui relève d’une caractéristique de certaines maladies, comme le MSEIR (rougeole, rubéole, par exemple). Dans ce modèle, le compartiment M représente les nouveau-nés avec une immunité passive, c’est-à-dire, ceux qui après la disparition des anticorps maternels de leur corps se déplacent vers la classe des sains, susceptibles d’être contaminés[182]. Une conséquence de ce que nous avons dit est que toutes les courbes de transmission ne sont pas des « courbes en cloche ».
Un autre domaine important de l’épidémiologie est la surveillance. La mise en place précoce de procédures de vigilance peut diminuer la période entre le commencement d’une épidémie et sa détection dans une population, ce qui est crucial pour réduire son impact. L’état actuel du réseau de surveillance est tragiquement insignifiant en regard des nécessités. Un tel réseau fait partie des buts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), fondée en 1948 comme agence de l’Organisation des Nations Unies et chargée d’établir priorités et directives pour « l’éradication des agents viraux ». Dans ce réseau, l’OMS doit coordonner les laboratoires certifiés, partout dans le monde, qui traitent des échantillons d’intérêt épidémique et relayent les informations vers l’organisation. Mais les résultats sont encore très faibles, voire ridicules[183], lorsqu’on comptabilise les coûts sociaux et humains des nombreuses épidémies graves déclenchées depuis la fondation de l’organisation. Une étude récente sur l’état actuel des réseaux de surveillance a conclu que la grande majorité des systèmes existants sont exploités de façon autonome en dépendant de la charité publique et que leur degré d’intégration effectif que ce soit pour les accès ou la transmission des informations locales laisse à désirer pour être à même de détecter et contrôler les épidémies locales, ainsi que de grandes difficultés dans la standardisation des critères de surveillance[184]. Mais peut-on attendre autre chose : des bourgeoisies nationales et de leurs Etats qui diminuent les investissements publics dans la santé, vus comme des faux-frais dans la production du maximum de la plus-value ? de la concurrence que se font ces Etats sur le marché mondial en méprisant la santé du prolétariat et de la population pauvre ? des industries pharmaceutiques dans leur farouche défense des profits des brevets ? de l’impuissance et ambigüités frappantes de l’OMS ?
Comme nous l’avons déjà dit dans le chapitre 2, la société communiste ne sera pas exempte de menaces virales. Mais, au contraire de la société capitaliste, dans le communisme, où l’argent et la forme valeur des produits du travail disparaît, c’est la communauté des producteurs associés qui prend les décisions et organise la société. Les obstacles dressés par le mode de production capitaliste qui favorisent l’émergence et empêchent la maîtrise rationnelle d’une épidémie seront éliminés. Ceci permettra le plein usage et le développement des connaissances scientifiques pour l’endiguement de la diffusion des maladies infectieuses, au sein de mesures sociales telles que l’abolition de la séparation entre ville et campagne, une répartition équilibrée de la population sur les territoires et de la mise en œuvre de mesures effectives de contrôle épidémiologique, comme par exemple un réseau mondial efficace de surveillance d’infections virales.
Quant aux modèles mathématiques de l’épidémiologie, seront-ils utiles dans cette société ? Malgré les grands progrès réalisés en presque 400 ans de modélisation en épidémiologie, il reste encore beaucoup d’incertitudes quant à la complexité de l’évolution d’une nouvelle combinaison des composants de la « triade épidémiologique » dus à de nouvelles épidémies émergeantes et, donc, de leurs représentations dans un modèle mathématique. Une bonne partie de la complexité introduite dans les modèles existants pour permettre une représentation plus adéquate des composantes de la réalité épidémiologique, par exemple, la modélisation des « facteurs environnementaux » de la triade (concentration démographique, augmentation anarchique du réseau d’interactions entre individus dans les transports publics, …), perdront de leur importance dans la société communiste, sans parler de la soumission des recherches aux vicissitudes politiques des organismes des Etats bourgeois, de leurs luttes idéologiques[185] et de manière plus générale aux intérêts du capital. Cette rupture radicale, à la suite de la révolution communiste, permettra l’allocation rationnelle d’une partie du travail social global pour que la recherche scientifique et ses modèles sur les maladies virales s’approchent toujours plus de l’essence de la réalité épidémiologique[186]. Comme le rappelait Marx :
« (…) toute science serait superflue s’il y avait coïncidence immédiate entre la forme phénoménale et l’essence des choses. » (Marx, Capital Livre III, t. VIII, chap. XLVIII, ES p. 196)
La connaissance scientifique s’approche donc de l’essence des phénomènes étudiés dans une succession continuelle de sauts qualitatifs tout au long de son évolution historique[187]. C’est ce que montre, par exemple, le petit historique de la modélisation mathématique en épidémiologie que nous avons évoqué ci-dessus, malgré toutes les avancées et les reculs imposés par le mode de production capitaliste. Pour être bref, cette évolution se réalise sur deux plans : endogène et exogène. Le premier concerne l’approfondissement et le développement de ses propres concepts, par leur mise à l’épreuve à travers des prédictions sur l’évolution des phénomènes qu’il faut expliquer. Cette confrontation entre la théorie et les phénomènes permet l’évolution/amélioration des concepts, voire leur abandon s’ils s’avéraient incapables de rendre compte durablement de la réalité. Le deuxième concerne la prise en compte des nouveaux phénomènes qui surgissent dans le champ de la recherche et leur intégration dans la théorie. La « vérité » progresse donc à la fois de façon continue en précisant son objet et par des sauts et des englobements. Les conceptions antérieures pour autant qu’elles conservent une validité deviennent alors des vérités partielles incluses dans les nouvelles représentations. Les choses réelles et leurs concepts se rapprochent les uns des autres sans jamais se recouvrir complètement, de manière asymptotique. Il existe donc une relation dialectique entre la vérité absolue et la vérité relative, entre la vérité et l’erreur, ce qui nous conduit à faire passer le relativisme à la trappe des idéologies de la science.
Sans les obstacles du mode de production capitaliste, le développement de l’épidémiologie, comme branche de la connaissance scientifique, permettra que les recherches qui s’efforcent de s’approcher de l’essence des phénomènes épidémiologiques puissent utiliser des modèles mathématiques plus appropriés, déjà débarrassés des notions et paramètres dus à l’anarchie des rapports sociaux capitalistes qui augmentent de façon nuisible leur complexité. Ceci ne veut pas dire que les modèles seront simplistes, mais que leur évolution dialectique les rendra plus aptes à représenter une réalité épidémiologique placée sous la surveillance globale de la communauté des producteurs associés.
6. La société communiste ne sera pas exempte des menaces virales
Il y a sans doute des formes d’interdépendance entre les maladies et à un moment donné, une forme de cohabitation[188]. Si cette relation vient à être modifiée, certaines maladies sont favorisées dont des maladies infectieuses[189].
Les antibiotiques, nous l’avons vu ont joué un rôle considérable dans l’augmentation de l’espérance de vie et dans la lutte contre les épidémies bactériennes. Mais, en même temps que leur usage se généralisait :
1. On observe un accroissement de la résistance des bactéries du fait de l’usage pour une part intempestif des antibiotiques (80 % sont utilisés dans l’élevage, mode de pensée métaphysique pour leur prescription, … ; 30 à 40% des antibiotiques se retrouvent intacts dans l’urine ou les fèces et ensuite entrent dans les sols, les nappes phréatiques et également dans l’eau potable, …)
2. De même que les antibiotiques sélectionnent certaines bactéries ce qui donne le champ libre à d’autres pour lesquelles il faudra d’autres antibiotiques pour les vaincre, le succès relatif (qui n’exclut pas des rechutes à mesure que les souches bactériennes deviennent plus résistantes) des antibiothérapies ont laissé un espace pour les épidémies virales. Bien entendu les inventeurs des antibiotiques n’étaient pas à imaginer les conséquences lointaines de leur invention.
Jamais l’eau dans les pays capitalistes les plus développés n’a été aussi propre et en même temps polluée par les molécules chimiques issues aussi bien de substances comme les produits phytosanitaires, les détergents, etc. ou encore des médicaments ou des pilules contraceptives[190]. On en est arrivé au point où les poissons des rivières changent de sexe amplifiant ou révélant ainsi un phénomène naturel à l’œuvre dans de nombreuses espèces de poissons.
Suivant les maladies, pour qu’une épidémie se développe, le regroupement de population doit avoir une certaine taille (plusieurs milliers, dizaines ou centaines de milliers). De ce point de vue, alors que la population urbaine à l’échelle mondiale est devenue majoritaire et que des villes dépassant le million d’habitants sont légions[191], les conditions pour favoriser une épidémie sont d’autant plus remplies que la différenciation entre les classes est forte.
On ne doit pas pour autant affirmer qu’une société communiste ne connaîtra pas la maladie ni les maladies infectieuses. Si une partie des facteurs qui favorisent les épidémies auront disparus, si l’essentiel de surmortalité due à l’insuffisance de l’organisation de la santé prise à la fois dans les rets du mercantilisme et les restrictions occasionnées par la recherche de l’abaissement relatif des coûts de santé comme à l’incurie de gouvernements conditionnés par le maintien en activité de la machine à produire un maximum de plus-value et à la soumission du prolétariat à l’ordre bourgeois, sera réduite, la relation de l’Homme et de la nature se poursuit et avec elle la lutte contre les maladies.
Si le socialisme réduit la concentration urbaine puisqu’il préconise la suppression des grandes villes[192] et une répartition équilibrée de la population sur les territoires, il n’en réduit pas pour autant, bien au contraire, les relations entre les personnes et les territoires[193]. Aussi il s’attend à ce que la part des forces productives consacrée aux transports et aux communications s’accroisse. La perspective du programme communiste tourne donc résolument le dos aux effets protectionnistes qui ne manqueront pas de se développer à travers cette nouvelle crise tout comme aux diverses variétés de localisme[194] (qui sont autant de formes de protectionnisme) promues par le socialisme petit-bourgeois. Utopique et réactionnaire ; il cherche à ramener la société dont il conserve la division du travail et ce qui est à la base de celle-ci : la séparation de la ville et de la campagne, la petite propriété, le salariat.
[La suite de ce texte sera consacrée à la mise à jour de l’évolution du cycle économique et comme nous en sommes arrivés à cette conclusion à un bilan du 11ème cycle d’après deuxième guerre mondiale de la production capitaliste aux Etats-Unis.]